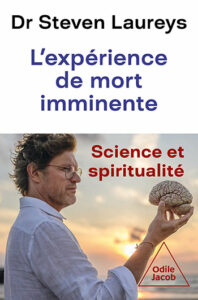
Le phénomène controversé de mort imminente intrigue le Dr Steven Laureys. «Les expériences sont encore plus difficiles à étudier que les rêves, car vous ne pouvez jamais prévoir quand quelqu’un vivra une EMI, une expérience de mort imminente», explique le spécialiste du cerveau. «En tant que scientifique, vous travaillez surtout avec des témoignages. Ce qui pose le défi immense d’objectivité des expériences personnelles.»
Ce n’est que lorsque le fondateur du Coma Science Group de l’ULiège a commencé ses recherches sur l’EMI que sa mère lui a confié qu’elle avait vécu une mort imminente à sa naissance. Elle n’avait rien dit pour qu’on ne l’empêche pas d’avoir un deuxième enfant.
Beaucoup de phénomènes nous échappent
Le directeur de recherche au Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) publie le récit de sa quête de savoir aux éditions Odile Jacob dans «L’expérience de mort imminente». «Je n’ai pas cherché à obtenir LA réponse absolue sur la vie et la mort. Ce qui me dérange dans tant d’autres livres, c’est cette certitude excessive. Ce manque de curiosité est ce que je trouve le plus déplaisant. Les gens critiquent facilement les opinions des autres, mais oublient de remettre en question leurs propres croyances.»
«La plupart des livres de vulgarisation scientifique sur ce sujet sont écrits par des cardiologues ou réanimateurs, ce qui est étrange. En tant que neuroscientifique, je constate que ces livres ne respectent généralement pas les standards requis. Être médecin ne fait pas de vous un spécialiste dans un autre domaine.»
«Autrefois, je voulais tout expliquer de manière rationnelle, mais aujourd’hui, je n’ai aucun problème à admettre qu’une grande partie des phénomènes du vivant nous échappe. Les EMI demeurent mystérieuses et fascinantes. Même après avoir écrit ce livre.»
Lors de moments émotionnels intenses
Les EMI ne se limitent pas aux personnes dans le coma ou victimes d’un arrêt cardiaque. Steven Laureys raconte que parmi les plus de 1.600 personnes interrogées, «beaucoup ont rapporté une EMI sans avoir vécu une situation de danger de mort. Parfois simplement lors de moments émotionnels intenses. Par exemple, pendant une méditation, en dormant, ou bien durant un orgasme.»
«Ces expériences pouvaient survenir même dans un état de conscience ordinaire. Ce sont ce que nous appelons des expériences similaires aux EMI. Une comparaison avec plus de 15.000 personnes ayant consommé des substances hallucinogènes a montré que ces drogues peuvent également déclencher des expériences très similaires.»
Croire les témoignages
Depuis des siècles, philosophes et scientifiques s’interrogent sur la réalité physiologique des EMI. Le conférencier au Collège Belgique rappelle qu’au XVIe siècle, le philosophe Michel de Montaigne a décrit des sensations et des émotions comparables à celles rapportées aujourd’hui par des témoins d’EMI.
«Une EMI se ressent d’une manière très différente d’un rêve ordinaire. C’est pourquoi il faut prêter beaucoup d’attention à ces récits. Ma position est de ne pas remettre en question la véracité d’un témoignage. Lorsque je vois qu’une personne a vécu une expérience comme si elle était réelle, je l’accepte. Mais en tant que neurologue, je sais aussi que notre cerveau peut rendre des expériences irréelles parfaitement crédibles. Notre équipe continue à mener ces recherches et nous sommes constamment à l’affût de nouveaux témoignages.»
Les EMI varient énormément. Le phénomène classique commence souvent par une expérience hors du corps. Suivie d’une expérience de tunnel, la vision d’une lumière et d’un sentiment de paix. «Tout comme pour les rêves, il existe des éléments reconnaissables. Mais chaque expérience suit son propre scénario.»
Les scientifiques sont subjectifs
Le contexte de vie influence l’interprétation d’une EMI. Un pratiquant d’une religion vivra ou exprimera probablement son expérience différemment d’un athée. Les enfants? «Ils sont généralement moins biaisés», note le neuroscientifique. «Même s’ils sont exposés, à la maison ou à l’école, à certaines valeurs, ne serait-ce que par les cours qui traitent de religion.»
Des scientifiques préfèrent éviter le sujet… «Si vous êtes un scientifique rigoureux et tenez à ce que tout soit mesurable, vous devez faire attention à ne pas traiter la science elle-même comme une religion. Je crois que la science doit être intrinsèquement non dogmatique.»
«Les scientifiques sont aussi des êtres humains subjectifs dans leur vision du monde», souligne Steven Laureys. «Accorder trop de valeur à une approche strictement scientifique est aussi une forme de subjectivité. Le véritable chercheur doit rester critique face à sa propre ignorance et aux limites de ses méthodes de recherche.»

