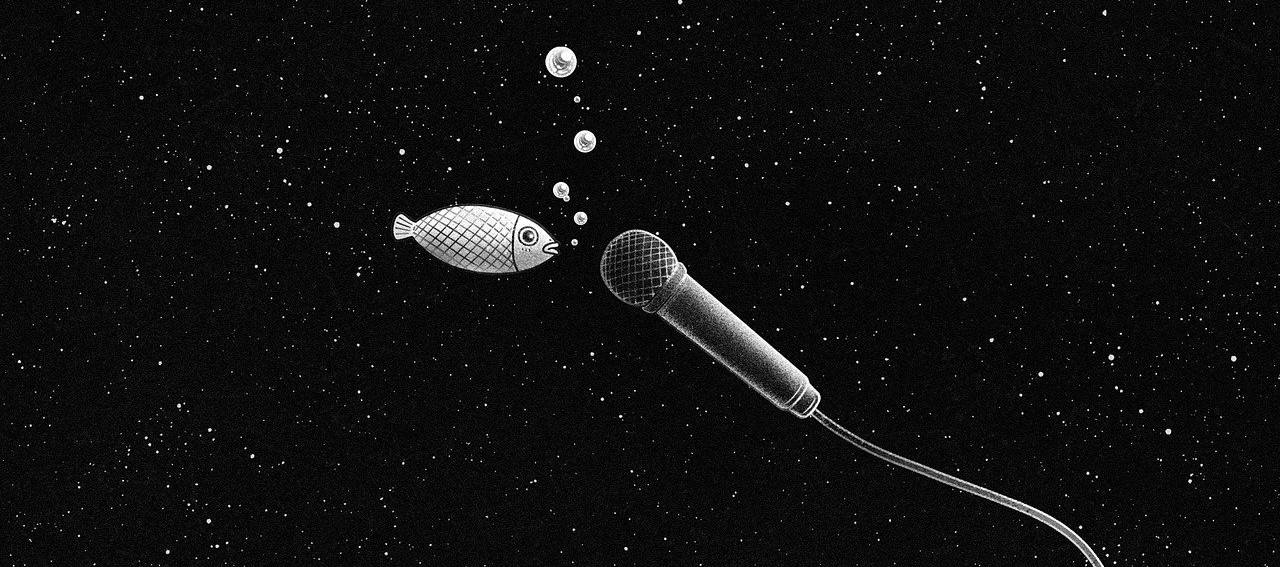Dans l’océan Indien, afin de faciliter leur tâche, les petits pêcheurs locaux placent au large des dispositifs de concentration de poissons (DCP). Ceux-ci consistent en des bouées ou des radeaux artificiels. Ces petites structures dures sont comme des oasis dans le désert océanique. Elles jouent le rôle d’abri pour les poissons qui s’y agglutinent, mais aussi de garde-manger. En effet, les invertébrés qui s’y logent constituent une source de nourriture pour les poissons de petite taille, qui eux-mêmes alimentent les plus gros. S’il est bien plus aisé d’y pêcher, certains de ces dispositifs vont désormais être utilisés pour aider les scientifiques à appréhender la biodiversité méconnue des poissons pélagiques, c’est-à-dire évoluant en haute mer.
Dans le cadre du projet européen MOOBYF (Monitoring the Open Ocean BiodiversitY with Fishers) financé par l’Europe via le programme BiodivErsa+, le Laboratoire de Morphologie Fonctionnelle et Évolutive de l’Université de Liège va se servir de ces DCP comme plateformes scientifiques en y fixant hydrophones et caméras.

L’image et le son
« Les hydrophones permettront de capter le soundscape ou paysage sonore. C’est-à-dire tous les types de sons émis par les crustacés, les poissons, les mammifères marins. Les caméras couplées aux hydrophones permettront l’identification de certains des auteurs de ces sons », explique Pr Eric Parmentier, directeur du Laboratoire de Morphologie Fonctionnelle et Évolutive de l’Université de Liège.
Précision qui a son importance : les hydrophones enregistreront automatiquement 10 minutes toutes les heures. « Capter du son, c’est facile, mais l’analyser, c’est autre chose. Il faut des heures et des heures de travail pour isoler chaque son d’une bande sonore d’à peine 10 minutes. Pour le moment, il n’existe pas encore de solution pour faire ces analyses de façon automatique.»
« Dans un second temps, nous nous concentrerons sur les poissons intéressants qui seront placés en aquarium afin de vérifier qu’ils sont bien les auteurs des sons enregistrés en pleine mer. »
D’une manière générale, les sons des poissons sont des pulsations, au contraire des sons des mammifères marins, lesquels sont des chants caractérisés par beaucoup plus de variations de fréquence. Ecoutez les sons émis par la Rascasse (Scopaena), la Donzelle douce (Ophidion rochei) et le Corb (Sciaena umbra), enregistrés dans des conditions naturelles lors d’une mission en Méditérranée par Pr Eric Parmentier et son équipe :
Bavardages sous-marins
Depuis quelques années, et grâce notamment aux travaux de l’équipe d’Eric Parmentier, la vision du monde sous-marin comme étant celui du silence a volé en éclats. Sur les 34.000 espèces de poissons connues, les vocalises de quelque 1000 d’entre elles ont d’ores et déjà été enregistrées. Attention que cela ne veut pas dire que les 33.000 autres sont muettes…
« Nous sommes spécialisés dans l’étude de la morphologie des poissons. Prenons l’exemple des Pomacentridés, une large famille de poissons des écosystèmes coralliens. Elle comprend notamment les 28 espèces de poissons-clowns connues. Si le son de seules 14 des espèces de poissons-clowns a été enregistré, l’étude morphologique nous enseigne que le mécanisme de production sonore est le même pour les 14 espèces qui restent. Et mieux encore, qu’il est le même pour les quelque 400 espèces que compte la famille des Pomacentridés. »
Dès lors, le chiffre de 1000 espèces de poissons productrices de son est largement sous-estimé.

Chez les poissons, la communication est souvent multimodale. Pour rester sur l’exemple des Pomacentridés, ces poissons émettent du son à un moment particulier de la journée en faisant une danse déterminée. « Pour faire passer leur message, ce n’est pas le son tout seul qui est important, mais l’association de plusieurs canaux de communication. » D’où l’importance de coupler son et image.
Analyse d’ADN environnemental
De l’ADN environnemental va également être prélevé sous les dispositifs de concentration de poissons. Lorsque les poissons évoluent dans l’eau, certaines de leurs écailles se perdent, du mucus est libéré. Si des cellules sont emprisonnées dans ces écailles ou dans le mucus, les prélèvements d’eau in situ suivis d’une analyse ADN pourraient indiquer la présence de l’espèce de poisson. A condition, bien sûr, que son ADN soit repris dans une banque de données. Ces informations viendront en complément du son et de l’image.
« L’ADN environnemental met une douzaine d’heures avant de se dégrader dans l’eau de mer. Mais une fois qu’on l’aura prélevé, l’ajout d’agents conservateurs permettra de le garder sur le long terme et de pouvoir l’étudier postérieurement », précise Pr Eric Parmentier.

Le projet MOOBYF, qui a débuté cette année et se clôturera en 2028, se caractérisera également par une large partie consacrée à la formation des petits pêcheurs locaux de Mayotte, des Maldives et d’Indonésie. Mieux connaître leur environnement, sa richesse et sa fragilité pourra permettre de les sensibiliser à la protection de la faune pélagique.