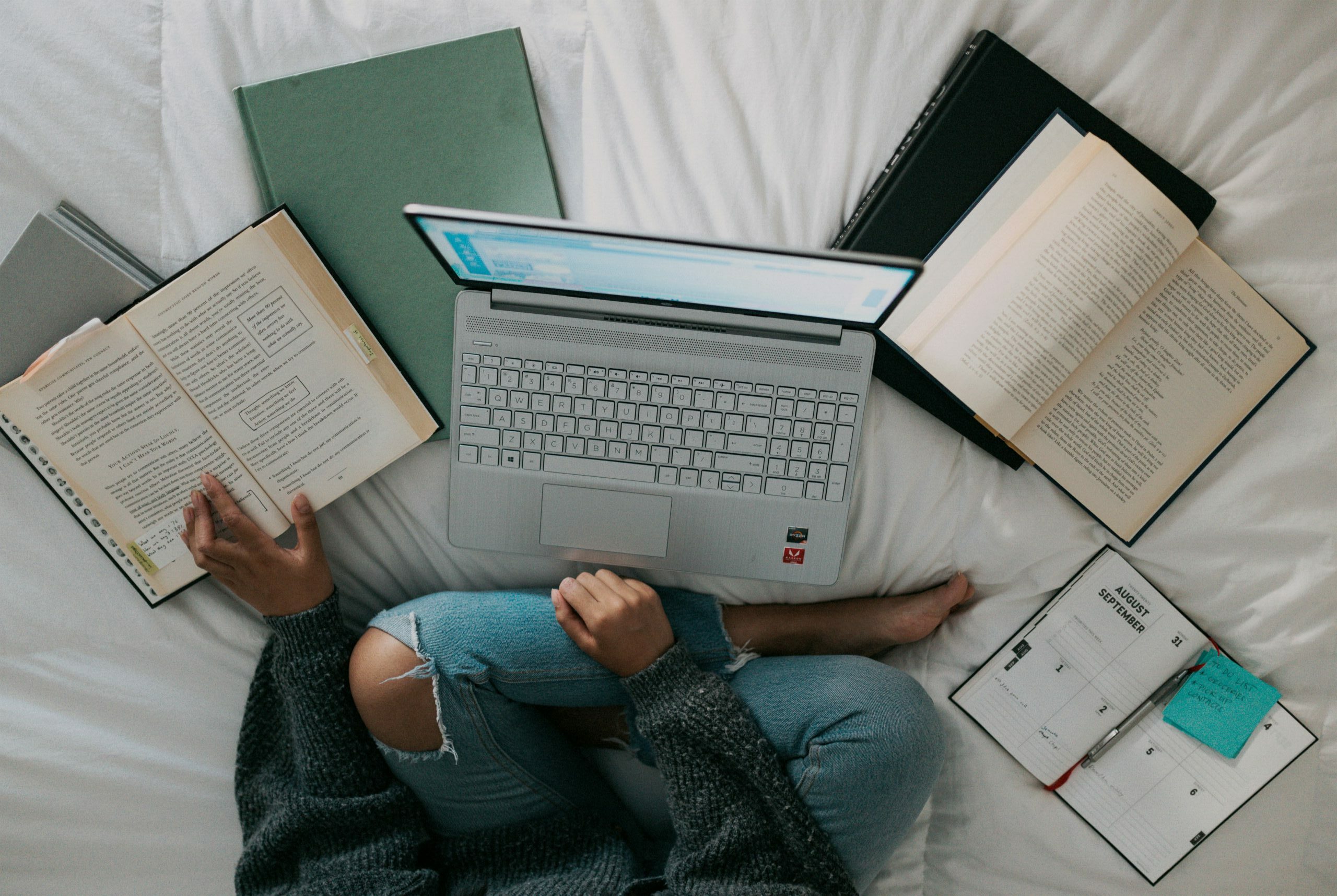Ecrire un email, résumer des notes de cours, traduire un document, produire des exemples de questions d’examens… Mais aussi rédiger automatiquement des écrits ou générer des bibliographies. En quelques clics, les plateformes d’IA générative comme ChatGPT et consorts facilitent le quotidien des étudiants, bousculant discrètement les règles du jeu académique.
Lors de la soirée-débat intitulée « Tricher, créer ou apprendre ? Ce que l’IA change à l’éducation » organisée par le Digital Lab – la plateforme de recherche et formation aux technologies numériques de HEC Liège – un étudiant, un chercheur-enseignant et un éthicien des technologies ont exploré les multiples facettes de l’arrivée fulgurante de ces outils dans le monde de l’enseignement supérieur.
Une nouvelle forme de triche ?
Sur les bancs universitaires, le recours à l’IA est devenu fréquent, notamment pour les travaux de rédaction. « Pour un grand nombre d’étudiants, l’écriture n’est pas un exercice facile. Il y a donc une tentation constante de se référer à ces outils qui, en quelques secondes, fournissent un texte a priori précis et argumenté », témoigne Thibaut Lefebvre, en dernière année à HEC Liège.
Faut-il y voir une forme de plagiat 2.0 ? Pour Louis de Diesbach, éthicien des technologies, cela dépend tout d’abord du règlement qui encadre son usage au sein de l’établissement : « : Il y a un adage en droit qui dit : il n’y a pas de crime, s’il n’y a pas de loi. S’il est précisé que les étudiants ne peuvent pas l’utiliser dans leurs cours, alors il y a faute, et donc punition.»
Reste que vérifier si un étudiant a bel et bien exploité une IA générative dans un travail est complexe. Les logiciels de détection ne sont pas infaillibles et, contrairement au plagiat classique, cette technologie génère du contenu original. Plutôt que d’interdire, il est sans doute plus pertinent pour l’enseignement de s’adapter. Fini les dissertations et essais réalisés depuis la maison, place aux évaluations “IA-résistantes” : oraux, travaux pratiques, exposés, rédactions en classe…
Une évaluation de l’écrit à revoir
Quand la rédaction à domicile est inévitable, comme pour les rapports de stages ou les mémoires/travaux de fin d’études, les enseignants devront sans doute repenser leurs critères d’évaluation. En se concentrant notamment sur les objectifs pédagogiques visés par la tâche. « Je pense que l’intérêt d’un mémoire, par exemple, est de produire une analyse critique », avance Louis de Diesbach. « Dans le cas où une IA a rédigé le mémoire, il pourrait être intéressant de demander à l’étudiant les prompts utilisés (NDA : instruction ou question posée à un modèle de langage comme ChatGPT). Si on constate que l’étudiant lui a demandé “écris-moi un mémoire de 80 pages, voici le sujet, merci beaucoup”, on peut mettre un zéro pointé. En revanche, si on observe une réflexion, une relance… Pourquoi pas ? »
Une opinion partagée par Bruno De Lièvre, directeur du service d’ingénierie pédagogique et du numérique éducatif de l’UMons : « Qu’a réalisé l’étudiant, et qu’a réalisé l’IA ? Que peut-il nous dire sur son sujet lors de la défense orale ? Je pense effectivement que c’est la compréhension de la problématique étudiée et la maîtrise de la méthodologie qui primeront de plus en plus à l’avenir dans l’évaluation. »
Professeur ChatGPT ?
Plus largement, l’impact de l’IA générative sur l’apprentissage a été discuté par les intervenants. Car cet outil peut aussi aider à approfondir un sujet, voire à acquérir de nouvelles connaissances. Selon Thibaut Lefebvre, confier totalement son éducation à une machine serait toutefois imprudent. Rappelant utilement que « la gestion d’informations de la part d’entreprises privées, et donc de leur filtre, soulève des questions. Si on ne sort jamais de l’écosystème de l’IA, on peut passer à côté d’informations plus controversées, critiques, sur le sujet étudié. »
Pour autant, d’après Bruno De Lièvre, l’IA peut aussi devenir une alliée pour les enseignants : « On peut l’exploiter pour augmenter nos propres compétences ou nous aider à mettre en œuvre des principes pédagogiques qui fonctionnent dans nos cours. Bien qu’on ne doive pas se cantonner à ce qu’elle fournit. La relation humaine avec l’étudiant a aussi son importance. L’enseignement à distance pendant la pandémie l’a d’ailleurs bien montré. »
Former les travailleurs de demain…
Face à ces bénéfices et limites, un constat émerge de la part des 3 invités : le besoin de former à un usage éclairé de l’IA. « On n’a pas le choix : la technologie est là, et elle sera de plus en plus présente à l’avenir. Il faut donc apprendre à la domestiquer, ce qui passe par l’éducation », affirme Bruno De Lièvre, qui distingue deux possibles niveaux de formation : l’un, général, axé sur la compréhension de ce qu’est l’IA et de son fonctionnement ; l’autre, plus spécifique, adapté aux métiers pour lesquels on prépare les étudiants.
Une formation de base pour l’ensemble des étudiants semble souhaitable, ne serait-ce que pour réduire (ou tout du moins éviter d’élargir) la fracture numérique (les inégalités d’accès, d’usage et de compétences face aux nouvelles technologies). A l’heure de l’IA, disposer de connaissances dans le domaine devient essentiel pour garantir l’inclusion et l’égalité des chances sur le marché de l’emploi.
…et des citoyens critiques
« Je dirais même que ne pas former les étudiants aux usages de cet outil serait une faute morale de l’université », soutient Louis de Diesbach. « Pas seulement pour préparer les travailleurs de demain, mais pour former des citoyens capables d’émettre un avis et d’avoir un recul sur ces technologies. Si l’université ne donne pas accès à ces compétences critiques, qui le fera ? »
Des compétences qui gagneraient même à être transmises dès le secondaire, voire dès le primaire. À partir du moment où il devient impossible de savoir si un texte, une image ou une vidéo a été généré par une intelligence artificielle, développer l’esprit critique de la jeune génération apparaît comme une priorité éducative. « S’il n’est pas nécessaire que tout le monde sache coder, il est essentiel que chacun soit conscient des enjeux et des impacts liés à ces outils », conclut Louis de Diesbach.