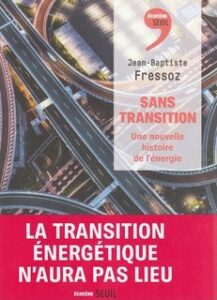
La lecture des histoires générales de l’énergie dérange l’historien des sciences, des techniques et de l’environnement Jean-Baptiste Fressoz. «Alors que le charbon vient de connaître un immense essor sur la plupart des continents, des ouvrages universitaires de référence sur le sujet racontent encore des histoires de transition entre systèmes énergétiques», constate le conférencier au Collège Belgique.
Le chercheur au Centre français de la recherche scientifique (CNRS) réplique en publiant «Sans transition». Un nouveau regard sur l’histoire de l’énergie paru aux éditions du Seuil. Pour comprendre la symbiose énergétique.
Les énergies ne sont pas en compétition
«Au lieu de considérer les énergies comme des entités séparées et en compétition, mon livre dévoile l’histoire de leurs intrications et de leur interdépendance», explique Jean-Baptiste Fressoz. «L’enjeu est immense, car ces relations symbiotiques expliquent la permanence des énergies primaires jusqu’à nos jours. Et constituent des obstacles majeurs sur le chemin de la décarbonation.»
«Je raconte la carrière étrange de la transition, une futurologie hétérodoxe et mercantile – un simple slogan industriel – qui est devenue, à partir des années 1970, le futur des experts, des gouvernements et des entreprises. Y compris celles qui n’avaient pas intérêt à ce qu’elle advienne.»
L’ancien maître de conférence à l’Imperial College London montre pourquoi la transition énergétique nous empêche de penser convenablement le défi climatique. «Depuis un demi-siècle qu’on l’invoque, cette notion a produit plus de confusion scientifique et de procrastination politique qu’autre chose. La transition projette un passé qui n’existe pas sur un futur fantomatique.»
Ne pas demander aux renouvelables plus qu’ils ne peuvent offrir
Cette nouvelle histoire de l’énergie ne critique pas la «transition»… «Si l’on entend par ce terme le développement des énergies renouvelables», précise Jean-Baptiste Fressoz. «Mais cette condition nécessaire est loin d’être suffisante. Et il est déraisonnable d’attendre des panneaux solaires et des éoliennes plus qu’ils ne peuvent offrir.»
L’essor des renouvelables n’est-il pas contradictoire avec le maintien d’importantes capacités fossiles? «Par exemple, dans l’ouest de la Chine, d’immenses parcs énergétiques ont été récemment inaugurés, associant panneaux solaires, éoliennes et centrales thermiques. Ces dernières, qui exploitent un charbon local bon marché, permettant de compenser la variabilité des renouvelables. Et de rentabiliser les coûts de raccordement particulièrement importants.»
Remédier aux arrêts dans la production d’électricité
Malgré l’envol des renouvelables, les émissions du secteur électrique continueront-elles d’augmenter dans le monde? «Le département de l’énergie américain, qui n’entre pas dans le jeu des scénarios zéro émission, prévoit bien une légère diminution des fossiles dans la production électrique. Mais elle serait suivie d’une stabilisation à un niveau élevé en partie pour pallier l’intermittence d’un système électrique dominé par les renouvelables en 2050.»
Le chercheur rappelle que la production électrique ne représente que 40% des émissions. Et que 40 % de cette électricité est déjà décarbonée grâce aux renouvelables et au nucléaire. «Sortir les fossiles de la production électrique mondiale représenterait un succès formidable. Mais insuffisant au regard des objectifs climatiques. Des pays très différents: de l’Éthiopie à la Suisse, en passant par la France, le Brésil ou l’Uruguay y sont d’ailleurs déjà parvenus. Sans que cela provoque une baisse drastique de leurs émissions.»
Il faudrait 1,2 million d’éoliennes
Il est moins évident de décarboner l’aviation. Le transport maritime. La production de matériaux comme l’acier, le ciment, les engrais ou le plastique, responsable de 3 à 5% des émissions mondiales. Un Étatsunien consomme en moyenne 4 fois plus de plastique qu’un Chinois. Et 15 fois plus qu’un Indien.
«En 2020, les trois quarts de l’acier mondial sont produits avec du charbon. Énormément de charbon: un milliard de tonnes en tout. Pour remplacer le coke sidérurgique par l’hydrogène électrolytique, il faudra l’équivalent de la production électrique annuelle des États-Unis. Ou encore celle de 1,2 million d’éoliennes, requérant à leur tour des quantités non négligeables d’acier.»
Pourtant, la puissance de séduction de la transition reste immense… «Son histoire et le sentiment troublant de déjà-vu qu’elle engendre doivent nous mettre en garde», conclut Jean-Baptiste Fressoz. «Il ne faudrait pas que les promesses technologiques d’abondance matérielle sans carbone se répètent encore et encore. Et que, après avoir franchi le cap des 2 degrés Celsius dans la seconde moitié de ce siècle, elles nous accompagnent tout aussi sûrement vers des périls plus importants.»

