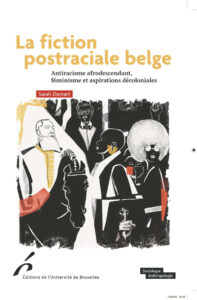
Sortie du terrain militant, Sarah Damart s’est mise à écrire par besoin d’objectivation et de prise de distance. La sociologue publie «La fiction postraciale belge – Antiracisme afrodescendant, féminisme et aspirations décoloniales» aux Éditions de l’Université de Bruxelles. Dans la collection Sociologie Anthropologie dirigée par le Pr Andrea Rea.
L’innocence blanche
Selon la fiction postraciale, le racisme est une affaire individuelle ou une idéologie relevant au mieux de l’aberration, au pire de l’extrémisme. «En Belgique, cette fiction ne semble pas pouvoir être résumée dans une seule formule du fait de la complexité identitaire belge sous-jacente à la formation de cet État tampon entre les grandes puissances européennes», explique la chercheuse cooptée par le Centre féministe de réflexion et d’action sur le racisme anti-Noir.e.s (BAMKO) avant sa fondation.
«La Belgique serait au fond une périphérie impériale du fait de la succession des dominations européennes qu’elle a elle-même subies, jusqu’à son indépendance. Face aux crimes qu’a engendrés la collecte du caoutchouc dans l’État indépendant du Congo, la propriété de Léopold II, le journaliste américain Adam Hochschild a parlé d’‘holocauste oublié’. Face au régime néocolonial ayant succédé à la ‘décolonisation’ du Congo, le sociologue belge flamand Ludo De Witte a quant à lui révélé la responsabilité de l’État belge et de la communauté internationale dans l’assassinat (et la destitution politique) de Patrice Lumumba, le Premier ministre congolais. Ces scandales ont donné lieu à des récits paradigmatiques – du début à la fin de la colonisation – qui font que la possibilité d’une ‘innocence blanche’ n’est jamais tout à fait acquise pour la petite Belgique.»
Un plan national antiraciste
En 2014, le Centre pour l’égalité des chances rappelle déjà à l’État belge la nécessité d’un plan antiraciste national. En 2016, c’est l’Universal Periodic Review, supervisé par le Conseil des droits humains de l’ONU, qui demande à la Belgique d’adapter un plan national de lutte contre le racisme. En 2019, c’est au tour du Groupe de travail d’experts des Nations unies sur les personnes d’ascendance africaine d’intervenir. En 2020, la Commission européenne appelle les États membres à mettre en place des plans d’action nationaux contre le racisme avant la fin de l’année 2022.
«La société civile flamande s’est emparée de cette question à partir de 2016», rappelle Sarah Damart. «Au moment où la Plateforme antiraciste francophone, initiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) s’épuisait. Pour ne pas dire se dissolvait.»
«Un premier mémorandum fut rapidement élaboré. Deux ans plus tard, une coalition National Plan Against Racism (NAPAR) voyait le jour, finissant par rassembler une soixantaine d’organisations francophones et néerlandophones.»
«La version actuelle du mémorandum (71 pages) embrasse une approche structurelle du racisme, laquelle met en minorité la conception hégémonique du racisme de la Plateforme antiraciste initiée par la FWB. La coalition récuse ‘une forme d’universalisme et de laïcité qui perpétue les discriminations au lieu de les combattre’ en mettant en cause l’intersectionnalité, en minimisant voire en niant l’islamophobie et le racisme structurel. Et en délégitimant et divisant la société civile antiraciste. Le mémorandum propose un plan antiraciste clé en main.»
Une politique active de décolonisation
La coalition NAPAR a rapidement acquis le statut de société civile auprès des administrations, des partis politiques et du gouvernement. La sociologue qui travaille à l’Observatoire du sida et des sexualités (ULB) souligne que «les 36 recommandations concernant le racisme anti-Noir.e.s énoncent de manière assez précise les revendications portées par les organisations afrodescendantes. Outre les mesures liées au racisme systémique et au développement d’outils statistiques permettant de collecter des données sur les inégalités, le mémorandum recommande ‘une politique active de décolonisation, et ce, dans tous les domaines politiques’, ainsi qu’une politique d’inclusion des personnes d’ascendance africaine et d’implication dans la lutte contre le racisme.»
Le mémorandum insiste sur la reconnaissance des expertises afrodescendantes et sur la nécessité d’une véritable politique de financement. Recommande une politique de réparation par rapport à la colonisation. L’application des mesures préconisées par les Nations unies lors de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine de 2015-2024.
«L’engagement de l’État n’ira pas au-delà de l’acte de lancement de la Décennie», relève Sarah Damart. «L’absence de plan d’action montre une nouvelle fois le refus de l’État de reconnaître le caractère structurel du racisme. Et la nécessité d’une politique de réparation vis-à-vis du passé colonial.»

