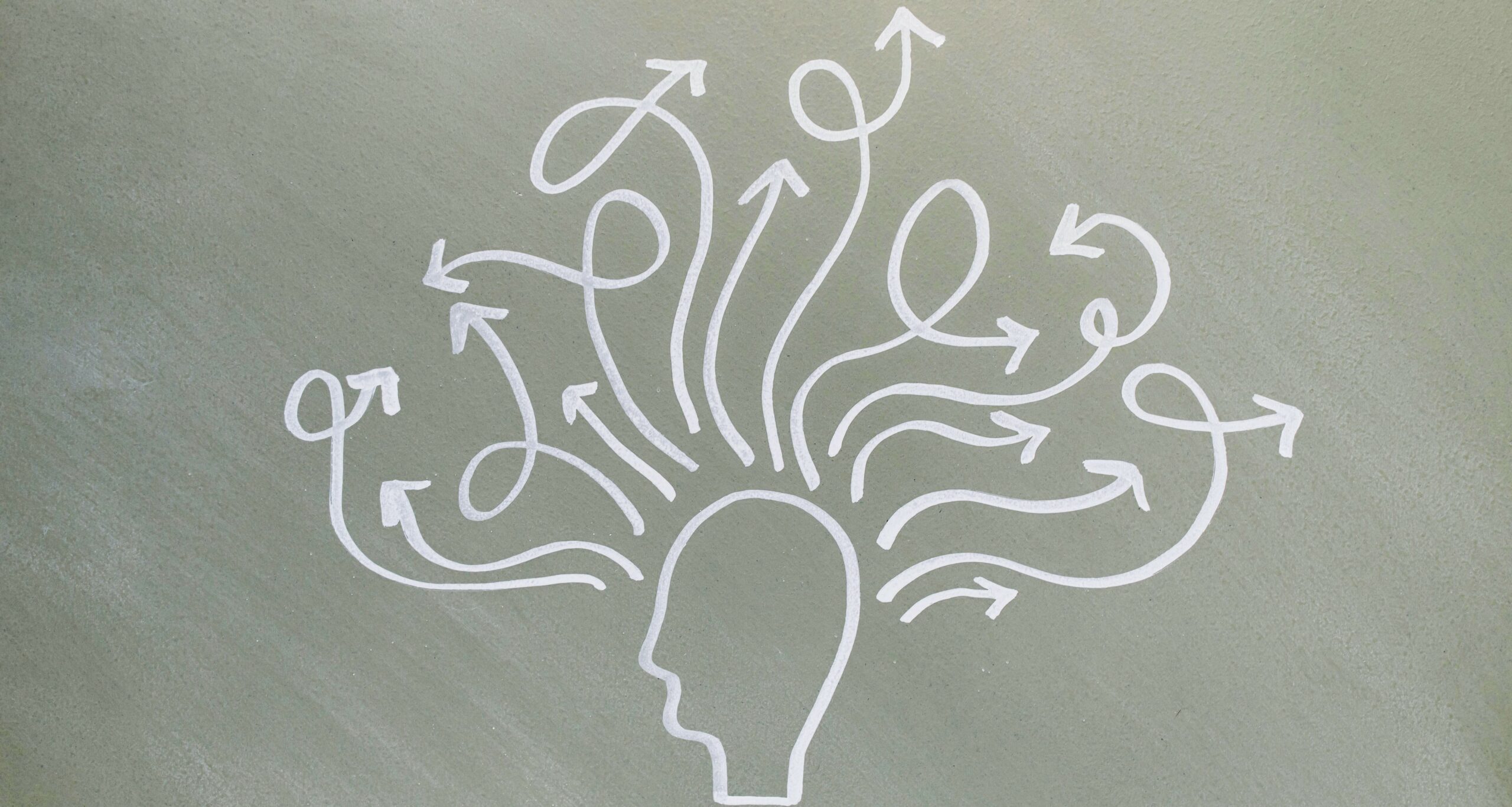Série : Plongée dans nos pensées (2/3)
En conduisant sur un chemin familier, on atteint sa destination sans souvenir précis du trajet. En pleine réunion, on se surprend à contempler les nuages par la fenêtre. Où est passée notre attention ? Elle a décroché, happée par un flot de pensées sans lien avec la route ou la discussion. Ce phénomène porte un nom : le vagabondage mental (mind-wandering, en anglais), et il occuperait près d’un tiers de nos pensées éveillées (34 %), selon une récente méta-analyse.
David Stawarczyk, chercheur qualifié FNRS à l’unité de recherche Psychology and Neuroscience of Cognition de l’ULiège, explore depuis plusieurs années les mécanismes psychologiques et cérébraux à l’œuvre dans cette errance de l’esprit. Il s’attache aujourd’hui à mieux comprendre les facteurs déclencheurs et la dynamique de ces épisodes.
La nature variée des pensées errantes
« Le format de ces pensées varie selon les individus. Elles peuvent prendre la forme de monologue intérieur, d’images mentales plus ou moins détaillées, ou un mélange des deux », précise le Dr Stawarczyk. Et leur nature est généralement neutre à positive : « Quand on demande aux participants de classer leurs pensées issues du vagabondage mental sur une échelle de -3 (très négatif) à +3 (très positif), celles-ci se situent en moyenne entre 0 et +1. »
Longtemps perçu comme un processus involontaire, et donc inconscient, le mind-wandering pourrait être délibéré chez certaines personnes. Mais s’agit-il encore d’errance mentale, ou plutôt de rêverie éveillée ? « La question est actuellement débattue », fait savoir le chercheur. Ce qui est sûr, c’est que ce comportement survient typiquement au cours d’une tâche exigeante ou, au contraire, jugée très facile.
L’attention mise en échec par l’effort ou l’automatisme
« La plupart des travaux sur le sujet suggère que le mind-wandering résulte d’échecs du contrôle attentionnel. Quand une tâche exige toute notre concentration, on mobilise en continu nos ressources cognitives. Or, et c’est tout à fait normal, on peut échouer à maintenir ce niveau d’attention. Celle-ci est alors capturée par autre chose, comme nos pensées. Plusieurs facteurs favorisent cette errance mentale : la capacité individuelle à rester concentré sur une tâche, le stress et les émotions négatives en général, la fatigue, la somnolence, etc. », développe le Dr Stawarczyk.
Mais ce n’est pas toujours lié à une défaillance de l’attention. « Plus l’activité en cours sollicite peu de ressources cognitives, plus le phénomène a des chances de survenir. Le cerveau exploiterait les ressources laissées libres quand on réalise des tâches demandant peu d’effort, routinières, voire ennuyeuses. »

Un phénomène utile au cerveau ?
Le cerveau, tire-t-il des bénéfices de ces moments de vagabondage ? Dans des travaux antérieurs, David Stawarczyk a découvert que 43 % des pensées produites lors de ces épisodes portent sur des événements à venir (contre 26 % sur le passé et 15 % sur le présent). Quand elles sont tournées vers le futur, elles visent la planification d’actions concrètes ou la recherche de solutions, généralement à court terme (dans le courant de la journée ou le lendemain). Exemple : « Il faudrait que je passe acheter du pain en rentrant » ou « Ce soir, je pourrais enfin finir la série que j’ai commencée. »
Par ailleurs, l’imagerie cérébrale montre que « l’ensemble des régions cérébrales désigné comme le “réseau du mode par défaut” est plus actif quand les participants rapportent des errances mentales ». Un réseau qui intervient dans la récupération de souvenirs d’épisodes vécus et de connaissances générales sur soi. Il joue aussi un rôle dans la projection, l’autoréflexion, ainsi que dans notre aptitude à comprendre, prédire et interpréter les intentions, croyances ou émotions des autres.
Tout cela suppose que le cerveau profite du vagabondage de l’esprit pour organiser nos expériences, anticiper l’avenir, et même renforcer la cohérence de notre identité.
Le double visage du vagabondage mental
À noter que si le mécanisme s’avère utile – exploration d’idées créatives, résolution de problèmes, planification utile du futur –, il peut aussi avoir des effets négatifs. « Certains auteurs avancent l’idée que l’errance mentale est pertinente selon le contexte et le contenu ». Lorsqu’elle survient au cours d’une tâche exigeant toute notre attention, elle peut parasiter notre concentration. La performance diminue, les erreurs augmentent, et le temps de réaction s’allonge. Et lorsque l’esprit dérive, non pas vers des pensées constructives, mais vers des soucis ou inquiétudes, on glisse alors dans la rumination mentale.
Afin de mieux distinguer quand cela nourrit la réflexion ou entrave la concentration, le Dr Stawarczyk étudie actuellement la dynamique du vagabondage mental. « Une caractéristique du phénomène est que les pensées s’enchaînent : je pense à ce que je vais manger ce soir, puis me rappelle que je n’ai pas mangé de spaghettis depuis un moment, ce qui me fait penser à la personne avec qui j’en ai mangé la dernière fois, ce qui me rappelle que je ne l’ai plus vue depuis longtemps et que je devrais la contacter… »
« Or, les personnes qui passent rarement d’un thème de pensées à un autre, ont aussi tendance à ruminer. À l’inverse, celles présentant un trouble de l’attention changent plus souvent de sujet de pensées. Les variations dans la dynamique du mind-wandering pourraient ainsi être indicatives de différents profils cognitifs ou troubles neurodéveloppementaux », conclut le Dr Stawarczyk.