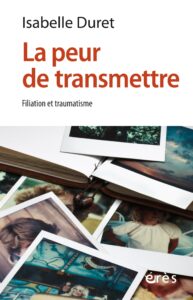
Depuis les années 1970, la question de la transmission d’une génération à l’autre a été progressivement évacuée. Remplacée par l’idée d’un monde sans passé pouvant donner l’illusion d’échapper aux héritages traumatiques. Aux éditions Érès, dans «La peur de transmettre – Filiation et traumatisme» , Isabelle Duret explore la transmission intergénérationnelle à travers des exemples vécus. Dans la collection «Relations – Familles, institutions, écosystèmes».
L’intérêt de la docteure en psychologie clinique pour la transmission a été éveillé lorsqu’elle pratiquait dans un hôpital d’une région très précarisée du sud de la Belgique. «J’ai rencontré des familles confrontées à des situations d’inceste, de maltraitance ou de négligence grave», raconte-t-elle. «J’ai, à plusieurs reprises, constaté que les parents agissaient comme s’ils n’avaient rien reçu de bon de leurs parents et qu’ils encourageaient leurs enfants à refuser toute forme d’héritage.»
«Deux jeunes garçons, Oscar et Daniel, que j’ai suivis – ainsi que leur famille –, ont éveillé ma curiosité. Ils se trouvaient tous les deux dans une situation intrigante qui consistait à fuir leur origine pour échapper au destin. Il m’a semblé que leurs problèmes relevaient des solutions imaginées par ces enfants ou leur famille pour échapper au destin douloureux. Pour éviter de répéter d’une génération à l’autre une expérience traumatique.»
Un sujet sensible
La responsable du Service de psychologie du développement et de la famille (UPDF) à l’Université libre de Bruxelles (ULB) explore les héritages familiaux dans des contextes traumatiques. «J’avais été frappée par certains groupes qui tentaient, me semblait-il, d’échapper à l’héritage en revendiquant le fait de n’avoir rien à transmettre.»
«Je ne me doutais pas que ce thème allait susciter en réalité, et à différents endroits – auprès des étudiants en psychologie à l’université, chez des collègues au Sénégal, dans le cadre de mes formations à la thérapie familiale, auprès de collègues psychanalystes – beaucoup de réactions très diverses, souvent très émotionnelles. Allant de l’incompréhension à l’agressivité en passant par toute une gamme de réflexions qui, cependant, ne laissaient jamais personne indifférent.»
Une réponse adaptée aux traumatismes
Tourner le dos à ses origines ou prescrire cette attitude à ses enfants peut être une réponse adaptée aux persécutions et aux traumatismes selon la psychologue. «Cette réponse s’inscrit dans un contexte culturel et social qui est le terreau fertile autant que la source d’inspiration.»
Les enfants écartés de la filiation paternelle ont souvent des mères qui ont subi une violence sexuelle, un inceste. «D’autres mères, anciennes victimes d’inceste, voient parfois dans leur enfant l’opportunité de parler du traumatisme sexuel subi qu’elles n’ont jamais pu exprimer et toujours mis au secret. Elles vont le projeter quelquefois sur leur mari ou compagnon qui sera accusé à tort d’avoir abusé des enfants. On parlera alors de fausses allégations et on passera à côté d’un cas de dévoilement d’abus sexuel subi par la mère. Par télescopage des générations, comme j’en ai rencontré plusieurs.»
S’extraire des situations douloureuses
Transmettre, c’est ne pas se laisser délester de notre histoire. S’y opposer, c’est nier le sens de la vie pense la professeure de psychopathologie. «Cela n’a rien à voir avec l’autonomie. Et peut renforcer l’enfermement, la fatalité et le poids du passé. En explorant de plus près des mythes sociétaux contemporains, on découvre un contexte propice à la suspicion, au déni. Voire à l’ingratitude envers ce qui nous a précédés.»
Des personnes issues de familles atteintes de maladies héréditaires craignent la transmission de gènes… «La découverte des mécanismes épigénétiques a permis de nuancer le fatalisme supposé du code génétique.»
«Transmettre, c’est engendrer l’avenir. Ce n’est pas reproduire, c’est poursuivre un élan. C’est reconnaître les traumatismes du passé pour s’extraire des situations douloureuses. La peur de l’avenir est plus présente encore pour ceux et celles qui, sur le plan familial, n’ont eu que peu d’éléments susceptibles d’éclairer leur passé.»
Lors de ses recherches, la formatrice en thérapie familiale systémique à l’ULB et à l’ASBL bruxelloise pour adultes La Forestière utilise des génogrammes, le test projectif par interprétation d’images (TAT), l’autoquestionnaire d’attachement pour adultes (Ca-Mir). En intégrant une approche multidimensionnelle et interculturelle.
«La transmission ne peut s’inscrire que dans une histoire, une mise en récit de celle-ci qui s’élabore dans le temps», souligne Isabelle Duret. «Elle est donc bien un outil pour que l’histoire se perpétue, se prolonge, à condition de n’être pas imposée et subie».

