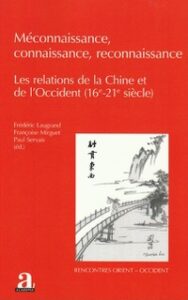
Connaissons-nous la Chine? Comprenons-nous la Chine? «Cette double question est revenue à l’avant-plan», constate l’historien Paul Servais. «Cela peut paraître surprenant à plus d’un titre. Le sinologue René Etiemble posait déjà la question, il y a plus d’un demi-siècle. Elle était reprise plus récemment lors d’un colloque à Louvain-la-Neuve avec toujours la même actualité. Et pourtant, ce ne sont ni les passeurs de connaissances du monde chinois, ni les canaux de transmission de ces informations sur ce même monde qui ont fait défaut au cours des cinq derniers siècles.»
Pour prolonger ce colloque, le professeur émérite de l’UCLouvain dirige, avec son collègue anthropologue Frédéric Laugrand et l’historienne Françoise Mirguet, «Méconnaissance, connaissance, reconnaissance – Les relations de la Chine et de l’Occident» aux éditions Academia.
Cette collaboration scientifique internationale présente notamment la culture chinoise à travers des phrases sentencieuses, la littérature, le théâtre. La phase chamanisme de la religion. La vision philosophique de Confucius. Le dépouillement des sources jésuites. L’alimentation. La fascination pour les insectes. Les canaux de communication entre la Chine et l’Occident.
Planter un drapeau et convertir les âmes
Un premier contact direct entre l’Europe et la Chine a lieu dans un contexte de conquête et de christianisation. Doctorante à l’Institut des civilisations, arts et lettres (INCAL) de l’UCLouvain, Huang Ching-Ya raconte «qu’à la suite des aventuriers qui avaient frayé le chemin à la curiosité de l’Europe envers le Nouveau Monde, ses peuples étrangers et leurs coutumes exotiques, les grandes puissances occidentales se lançaient dans un projet de conquête à double voie: planter leur drapeau sur de nouveaux territoires. Et convertir les âmes des populations soumises».
«Face à ces avances, la Chine, néanmoins, restait impénétrable à tous les égards. Fière de sa riche culture millénaire, elle se considérait la seule civilisation du monde. Rejetait tout ce qui venait du dehors de ses frontières. Le mépris envers les étrangers, synonyme de barbares pour les Chinois, ne pouvait qu’augmenter avec les harcèlements fréquents qu’ils subissaient de la part des pirates et des commerçants malhonnêtes qui hantaient les côtes. Devant les menaces d’outre-mer, venant d’un monde qu’elle jugeait inculte, la Chine gardait ses portes fermées. Et constituait depuis longtemps un monde à part.»
La présence jésuite en Chine remonte à la fin du 16e siècle. Ces missionnaires portugais étudient la langue et la culture chinoises. Pour faciliter leur travail d’évangélisation. Communiquer, lire et écrire les caractères.
Six mois pour atteindre l’empire du Milieu
Nanxin Fu, chargée de cours à l’Université de Montréal, souligne que, «bien avant les missionnaires, les autorités et les commerçants français cherchaient à établir une route maritime directe vers l’Extrême-Orient en général. Et vers l’empire du Milieu en particulier, expression utilisée pour désigner la Chine».
Parti de La Rochelle en 1698, le vaisseau Amphitrite atteint la Chine en six mois. «Cet événement historique peut signifier le point de départ des relations franco-chinoises. Les navires français de la Compagnie royale ont commencé à effectuer les traversées régulières qui entraînaient un afflux de marchands et jésuites français vers l’empire du Milieu.»
Les insectes musiciens fascinent
Margot Coetsier de l’UCLouvain a constaté la présence constante d’insectes dans les arts, la médecine, l’économie, les jeux d’enfants, les récits de la formation de l’Univers.
«En Chine, cette admiration pour le son des insectes remonte aussi loin que la période de la dynastie des Tang, qui régna sur la Chine de 618 à 907 et plus particulièrement à l’ère de Tianbao. C’est à cette période qu’on peut observer les premières pratiques de chasse et de mise en cage des criquets, katydids et autres insectes musiciens. C’est d’abord au sein des classes nobles et des membres du palais impérial que s’est développée une première fascination pour les insectes. Les femmes nobles se promenaient dans les jardins impériaux pour pouvoir écouter et attraper les criquets chanteurs qu’elles plaçaient dans de petites cages dorées.»
Les criquets sont aussi appréciés pour leur combativité à partir de la période des Song, en 960-1278. Éleveurs et spectateurs parient sur la survie d’un des deux insectes qui se battent jusqu’à la mort dans une boîte ronde. Ces combats sont officiellement interdits à la fin de la dynastie Qing, en 1912. Des fortunes entières ont été dilapidées…
Proclamée en 1949 par Mao Tsé-toung, la République populaire de Chine maintient cette suppression jusqu’à la fin de la révolution culturelle en 1976, à la mort de l’homme d’État. «C’est à partir de 1976 que les combats de criquets se rétablirent et grimpèrent rapidement en popularité.»

