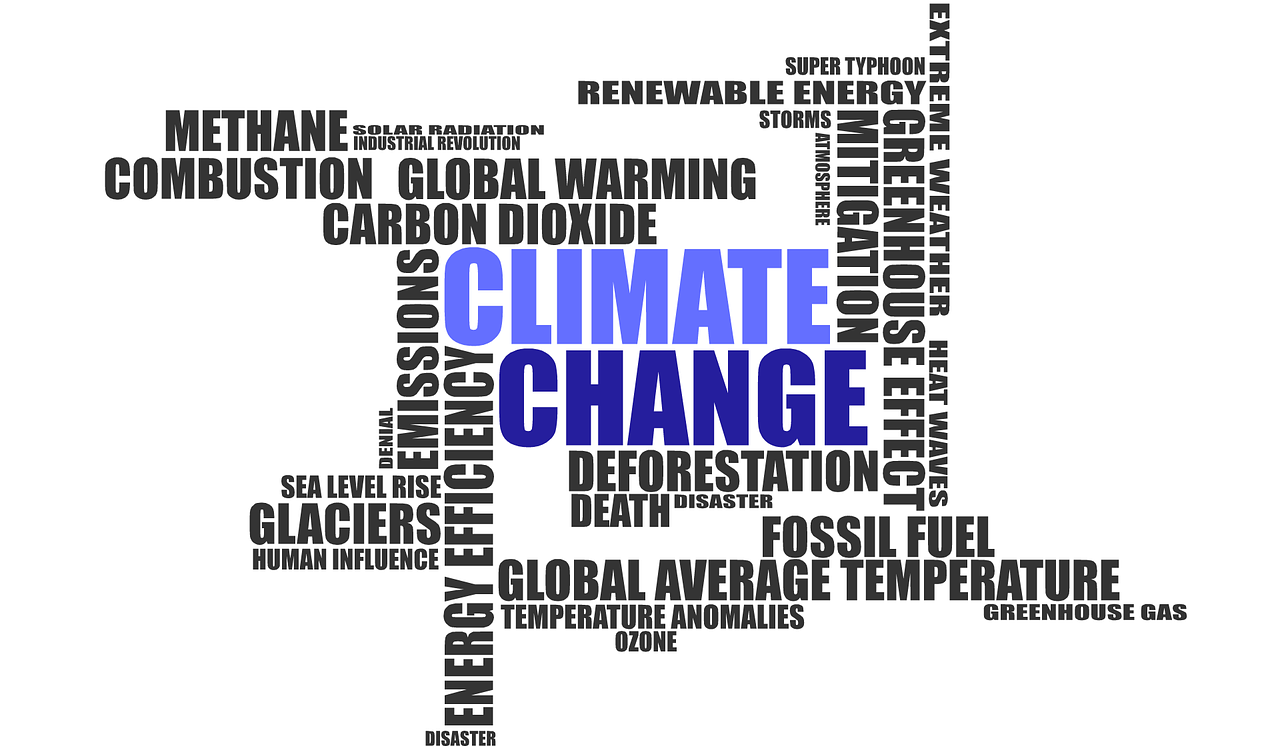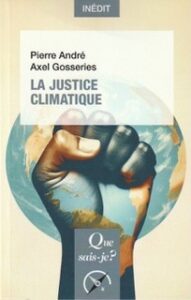
«La justice climatique»… L’expression désigne les actions intentées devant les tribunaux contre l’attentisme climatique des États ou la poursuite des activités extractives des multinationales. Les mouvements sociaux l’invoquent pour exiger un passage plus ambitieux et plus équitable vers une économie décarbonée. Les négociateurs des COP, les conférences des États signataires de la convention-cadre des Nations unies, en font une pièce maîtresse de leur argumentaire. Pierre André et Axel Gosseries l’ont choisie pour titrer leur livre aux éditions Que sais-je?.
Enseignants à l’UCLouvain, le docteur en philosophie et le spécialiste des théories philosophiques de la justice éclairent les principales questions philosophiques soulevées par la limitation du réchauffement planétaire. Comme le partage équitable du budget carbone. La responsabilité des pays riches, les premiers industrialisés. L’obligation de changer de vie ou de militer pour une politique climatique. La façon d’aborder les techniques controversées de captage du carbone ou de gestion du rayonnement solaire.
Se mettre d’accord sur les faits
Les deux chercheurs du FRS-FNRS, le Fonds de la recherche scientifique, fournissent des outils pour dialoguer. Se positionner de manière critique sur les mesures de lutte contre le changement climatique mises en œuvre, ou proposées. À l’échelle individuelle, nationale, internationale.
«Dans le débat climatique, nous mobilisons non seulement des faits scientifiques, mais aussi des concepts, des valeurs et des normes», soulignent-ils. «Se mettre d’accord sur les faits est crucial. Il est, en effet, tentant pour les adversaires des politiques climatiques de semer le doute sur le réchauffement planétaire et ses causes plutôt que de s’engager sur les valeurs et les normes. Le rôle du GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, est donc essentiel.»
Le problème est politique et social
Recourir à la notion de «justice climatique» présente des avantages. «Ce cadrage tranche avec des discours dominants faisant la part belle à la science et à la technologie. Il souligne que le changement climatique est un problème profondément politique et social.»
Les politiques climatiques ont un coût… «Les agents collectifs peuvent réduire ces coûts de la transition grâce à des économies d’échelle», jugent les chercheurs. «Notamment dans les domaines des transports, du logement ou de l’énergie. De plus, une redistribution équitable permet de réduire les coûts supportés par les plus désavantagés. Par exemple, en reversant les recettes d’une taxe carbone aux citoyens sous la forme d’une allocation universelle. Ou en subventionnant l’adaptation des ménages les plus pauvres.»
«Cette redistribution de l’effort vise à faire porter le coût de transition non pas par ceux qui n’en ont pas les moyens, mais plutôt par ceux qui ont les épaules les plus larges.»
Des changements de comportement sont inévitables
Réduire volontairement l’émission de GES, les gaz à effet de serre? «Ces réductions peuvent augmenter l’acceptabilité politique de la transition. Même si elles se révélaient inefficaces pour réduire directement les dommages causés par le changement climatique. Ces efforts individuels pourraient indirectement constituer une forme de plaidoyer efficace à l’égard des autorités publiques. Des entreprises et des autres individus.»
Et si les plus désavantagés n’ont pas les moyens de réduire leurs émissions de GES? «On peut penser que c’est aux plus avantagés de financer leurs réductions d’émissions, sur la base de leur capacité de payer. La capacité morale de l’individu pourrait être tantôt inférieure, tantôt supérieure, à une responsabilité qui serait strictement proportionnelle à ses émissions.»
Créer l’effet boule de neige
«En se déplaçant à vélo, par exemple, il se peut que j’encourage d’autres à faire de même en leur montrant que cette option est non seulement possible. Mais également porteuse de cobénéfices en termes de santé et de bien-être. Ensuite, un nombre plus important de cyclistes pourrait inciter les municipalités à aménager davantage de pistes cyclables. Les industriels à produire plus de vélos. Moins de voitures.»
Encore faut-il, pour Pierre André et Axel Gosseries, que «ces actions individuelles de plaidoyer – que ce soit par des moyens démocratiques classiques, la désobéissance civile ou des changements de comportement – ne soient pas elles aussi qu’une goutte d’eau dans l’océan. À cet égard, on parie que ces actions s’additionnent pour créer un effet boule de neige.»
Les deux philosophes concluent que «la justice climatique doit être conçue non pas en silo, comme un problème isolé. Mais toujours en lien avec nos préoccupations plus générales de justice sociale. De démocratie et d’éthique environnementale.»