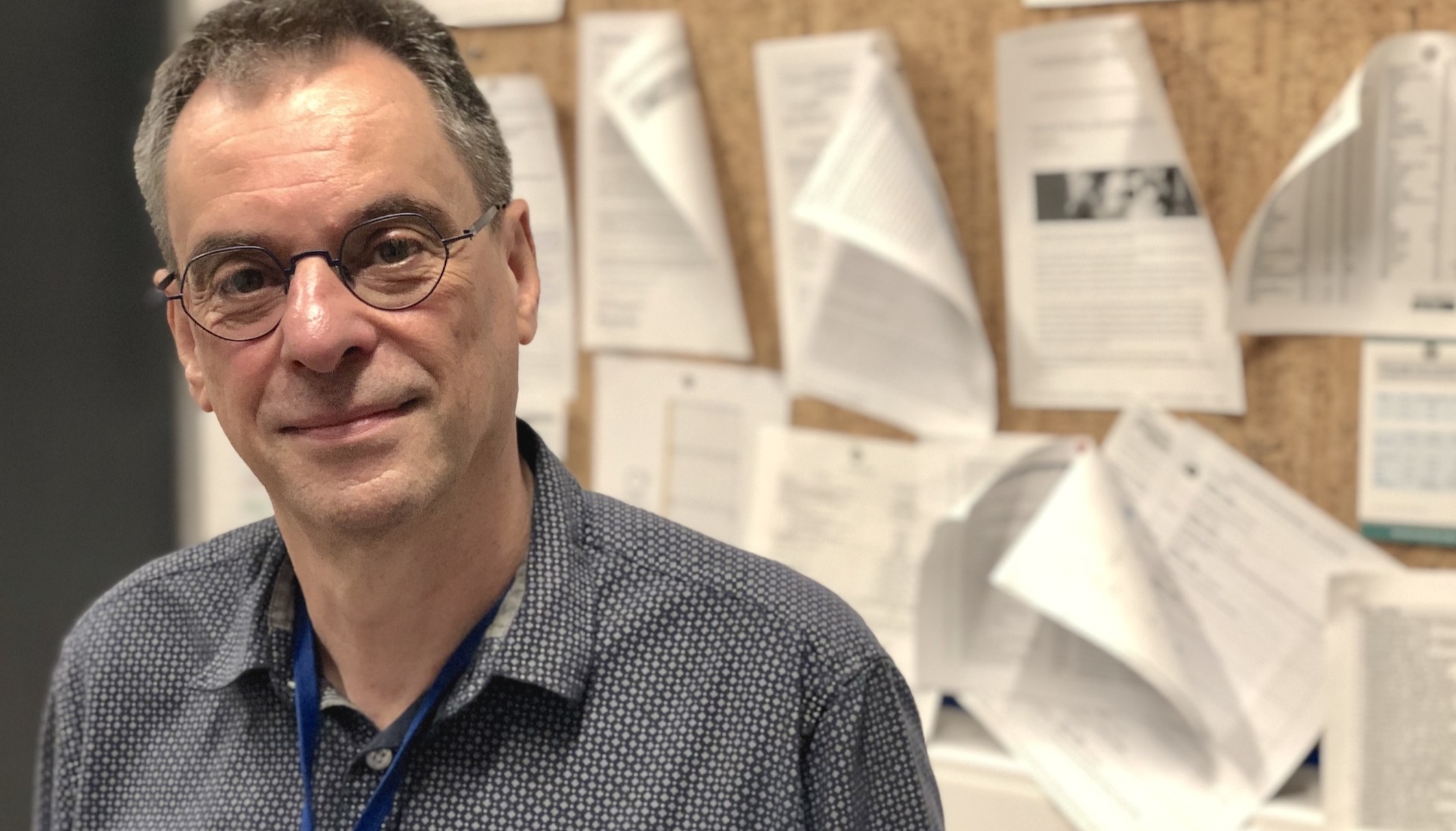PODCAST
Série : Prix Quinquennaux du FNRS (6/6)
Lauréat du Prix en Sciences biomédicales cliniques (Prix Joseph Maisin), Peter Stärkel est Professeur et chef de clinique à l’UCLouvain. Selon le jury, « l’approche de Peter Stärkel en matière de recherche clinique translationnelle a permis de mieux comprendre les maladies hépatiques chroniques liées à l’alcool. Sa recherche se concentre sur un problème clinique d’importance mondiale et a déjà attiré l’attention internationale. Le travail de Peter Stärkel est de la plus haute qualité – c’est un clinicien-scientifique exemplaire », indique le jury.
Comment Peter Stärkel fait-il, depuis plus de 25 ans, et la création de l’unité d’alcoologie aux Cliniques Universitaires Saint-Luc, pour identifier les liaisons dangereuses entre les dommages causés par l’alcool au niveau de l’intestin et la manière dont ceux-ci influencent le développement d’une maladie du foie? En recherche biomédicale, on compte souvent sur des modèles animaux pour mener ces études. Ici, ce n’est pas le cas, comme l’explique le lauréat.
« Dans notre domaine, les recherches chez l’animal sont difficiles parce qu’on ne dispose pas vraiment de bons modèles reproduisant complètement ce qui se passe chez l’homme », explique-t-il. « Nous devons passer directement à la recherche translationnelle chez l’être humain et sur des échantillons humains de l’intestin, du foie, du sang et éventuellement urinaires. Nous pouvons y mesurer énormément de choses qui nous renseignent sur la maladie ».
Ce qui pose bien entendu certains problèmes éthiques. Le scientifique rassure: toutes ses recherches sont strictement encadrées à ce propos par les comités ad hoc.
Stigmatisation de la maladie auto-infligée
« Dès le début de notre unité d’alcoologie, nous avons réfléchi à la manière de créer des projets de recherche. Nous avons conçu l’unité pour, à la fois, fournir des soins d’excellence, et élaborer des projets de recherche spécifiques. Nous avons standardisé tout ce qui se fait ici, comme les prélèvements chez les patients, afin de pouvoir mener ensuite des analyses complémentaires de recherche.»
Au fil des 25 dernières années, les défis n’ont pas manqué. Outre la création de l’unité et le recrutement du personnel, la recherche de fonds pour la recherche reste une préoccupation constante. « Ces analyses coûtent cher, même si on peut faire des prélèvements de routine chez l’Homme », dit-il. « Et donc, sans financement, sans soutien, on ne peut pas lancer ce type de recherche. De plus, la connotation souvent négative de l’alcoolisme n’aide pas. Les maladies liées à un abus d’alcool véhiculent une image négative dans la société, mais aussi du côté des industriels, et même, parfois, dans le monde scientifique. Donc on hésite, on ne veut pas être associé à cette image négative. Et du côté des fonds officiels, pour les projets de recherche liés à l’alcool, il n’y a pas d’appels spécifiques. Je pense que c’est cette stigmatisation de la maladie auto-infligée qui fait qu’on ne donne pas facilement de l’argent pour ce type de recherche. »
Le Prix Quinquennal qui le récompense pourrait-il changer la donne? « Clairement, cette visibilité est importante pour la sollicitation de financements. Cela permet aussi de passer un message: celui de la vraie nécessité qu’il y a de s’occuper de ces malades-là et de comprendre pourquoi certains font des maladies liées à un abus d’alcool et d’autres très peu ou pas du tout.»