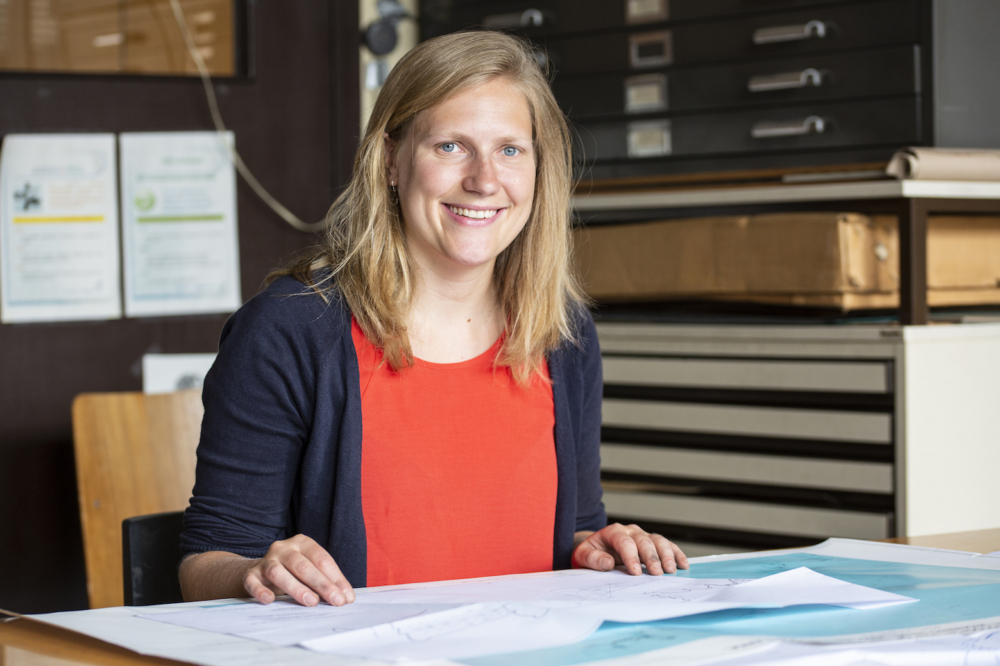SERIE (2/6) Têtes chercheuses
Au sortir de l’école secondaire, Sophie Berger, ne savait pas trop dans quelle filière s’engager. Opter pour la géographie a été sa manière de faire un « non-choix ». Sa priorité : garder un horizon le plus ouvert possible. Un mode de vie que ses recherches concernant la stabilité de l’Antarctique sur base d’images satellitaires et sa future expédition au pôle Sud ne démentent pas.
«J’ai l’habitude de faire des choix qui me permettent de garder un maximum de portes ouvertes. A l’ULB, tous les cours de géographie physique étaient donnés par des glaciologues ; j’ai fini par faire mon mémoire dans ce domaine, suivi d’un doctorat à l’unité de glaciologie de l’ULB. Un chercheur de l’Institut Alfred-Wegener m’a proposé de travailler sur l’interférométrie radar. J’y ai vu une opportunité et j’ai eu envie de relever le défi. Voilà comment j’ai commencé à étudier l’Antarctique à Bremerhaven en Allemagne. Et l’Antarctique, plus on s’y intéresse, plus cela devient passionnant, voire une obsession ».
Un équilibre instable
Motivée par l’aspect environnemental du sujet et son lien avec les changements climatiques, le Dr Berger travaille dès 2013 à l’observation et l’étude de la stabilité de l’Antarctique. Ce continent qui fait 1,4 fois la taille de l’Europe et sur lequel la glace accumulée mesure en moyenne 2 kilomètres d’épaisseur.
« La glace est apparue de manière assez simple : comme on est très près du pôle Sud, il y fait très froid, donc la neige tombée au fil des siècles s’est compactée jusqu’à former de la glace. Si toute cette glace fondait, cela ferait monter le niveau marin d’environ 60 mètres » explique la chercheuse.
La glace de l’Antarctique n’a rien à voir avec de l’eau gelée. Car si à petite échelle un bloc de glace semble solide, à l’échelle d’un glacier ou de l’Antarctique, la glace se comporte comme un flan ou un liquide très visqueux, tel du miel. On peut imaginer le continent austral comme une assiette avec un gros flan. Si l’on met un flan sur une assiette, il s’étale vers le bord. C’est exactement ce qui se passe avec l’Antarctique.
« Il y a énormément de glace », explique le Dr Berger, « et une fois qu’elle arrive au bord et entre en contact avec l’océan, par un effet de densité, la glace flotte. »
Au moment où la glace se met à flotter, elle va former ce que l’on appelle des plateformes de glace ou ice shelves, qui restent rattachées à la glace reposant sur le continent. Ces ice shelves ont un rôle fondamental car ils ont un effet « arc-boutant » (buttressing effect) et retiennent la glace en amont. On peut les comparer à un robinet pour le reste de la calotte glaciaire. Enlever de la glace au niveau de ces plateformes flottantes – par fonte à leur base ou par détachement d’icebergs – équivaut à ouvrir le robinet beaucoup plus grand ou à enlever le bouchon et déverser des flux de glace beaucoup plus grands dans l’océan.
Tout et son contraire
Quand on lui demande si l’on peut en déduire que la fonte des glaces n’est pas une légende, Sophie Berger rit et répond “oui ” ! Pour ceux qui en douteraient encore, la chercheuse a quelques arguments à opposer mais, en bonne scientifique, elle se méfie des certitudes.
« Les contributions actuelles de glace fondue transmises à l’océan, et qui font monter le niveau marin, proviennent à 59 % des petits glaciers et des petits corps de glace, en Islande ou dans les Alpes, par exemple. L’Antarctique n’y contribue que pour 18%. »
A contrario, si l’on observe les volumes de glace, le continent blanc représente 88% des stocks de glace. Ce qui en fait, dans les projections futures relatives à l’élévation du niveau des mers et océans, le plus gros contributeur potentiel. Mais aussi le plus incertain. En fonction des scénarios et des chiffres, l’Antarctique contribuerait à modifier le niveau marin de -10 cm (il freinerait la hausse du niveau des mers) à + 50 cm (il deviendrait un contributeur essentiel de la hausse du niveau de la mer).
« A ce stade, poursuit la chercheuse, les données ne permettent pas d’avancer des prédictions crédibles. L’Antarctique est le continent le plus froid au monde. Imaginons qu’il fait en moyenne -20 degrés. On sait qu’au pôle les températures se réchauffent plus vite qu’ailleurs. Mais même si la température se réchauffe de 5 degrés – ce qui est déjà énorme – -15° reste toujours trop froid pour faire fondre la glace. Le surcroît d’humidité dans l’air et de précipitations neigeuses alimentent et font croitre l’Antarctique. C’est pour ces raisons que certains modèles prédisent une augmentation de la taille de la calotte. Mais on s’est rendu compte, beaucoup plus récemment, que l’Antarctique est en train de perdre de la glace de manière accélérée, à cause du contact avec l’océan dont la température augmente. Conséquence : une grosse perte sur la partie posée (et donc non flottante) de l’Antarctique.
Du plus grand au plus petit
« Les scientifiques sont très précautionneux avant d’émettre des conclusions. Dans un premier temps on fait un constat, on regarde, on essaie de comprendre ce qui se passe et ensuite on modélise. Les deux étapes sont nécessaires. Sans les observations, on ne saurait pas que l’Antarctique est en train de perdre de la glace. Mais on a besoin de la modélisation si l’on veut essayer de reproduire le comportement et l’écoulement de la glace et prédire le futur de la calotte. »
Ces modèles sont alimentés par les données du GIEC, l’organe de référence en matière de changement climatique. Grâce au GIEC, les scientifiques s’accordent sur différents scénarios d’évolution d’émission des gaz à effet de serre. En découlent des paramètres utiles pour les modèles de prédiction d’écoulement des glaces en Antarctique.
A l’heure actuelle, le Dr Berger se concentre sur l’analyse d’images satellitaires. Néanmoins, il n’est pas question de faire l’économie d’expédition sur le terrain.
« Aller sur le terrain, explique la scientifique, permet de calibrer les données, de les confronter en utilisant le radar ou simplement des bambous dont on mesure la position d’une année à l’autre, ce qui informe sur la vitesse de mouvement des glaces. Ensuite, ces infos sont confrontées à celles reçues de l’espace. Faire de la recherche sur l’Antarctique uniquement depuis son ordinateur, c’est comme découvrir une ville sur base de cartes sans déambuler dans les rues. »
Et la vie après la thèse ?
« Je ne suis pas sûre de vouloir continuer dans la recherche toute ma vie mais on m’a proposé un projet de post-doc basé sur ma thèse et j’ai été tentée par une expérience à l’étranger. Par ailleurs, mon rêve était de partir en Antarctique et il fallait pour cela travailler dans un des labos où il y a le plus de chances de participer à une expédition. »
Les cerveaux belges doivent-ils quitter la Belgique pour rencontrer de vraies opportunités ?
« Je pense que oui. Il faut se diversifier au niveau scientifique même si humainement parlant ce n’est pas toujours facile. Il est sain de travailler avec d’autres personnes et dans une autre atmosphère. Les labos suivent une certaine école de pensée, quelques promoteurs et professeurs induisent une certaine vision qui ne correspond pas à l’approche d’autres personnes en Europe et dans le Monde. Voyager, c’est découvrir un autre fonctionnement et se rendre compte que ce qu’on a vécu n’est pas forcément la réalité de tout le monde. »