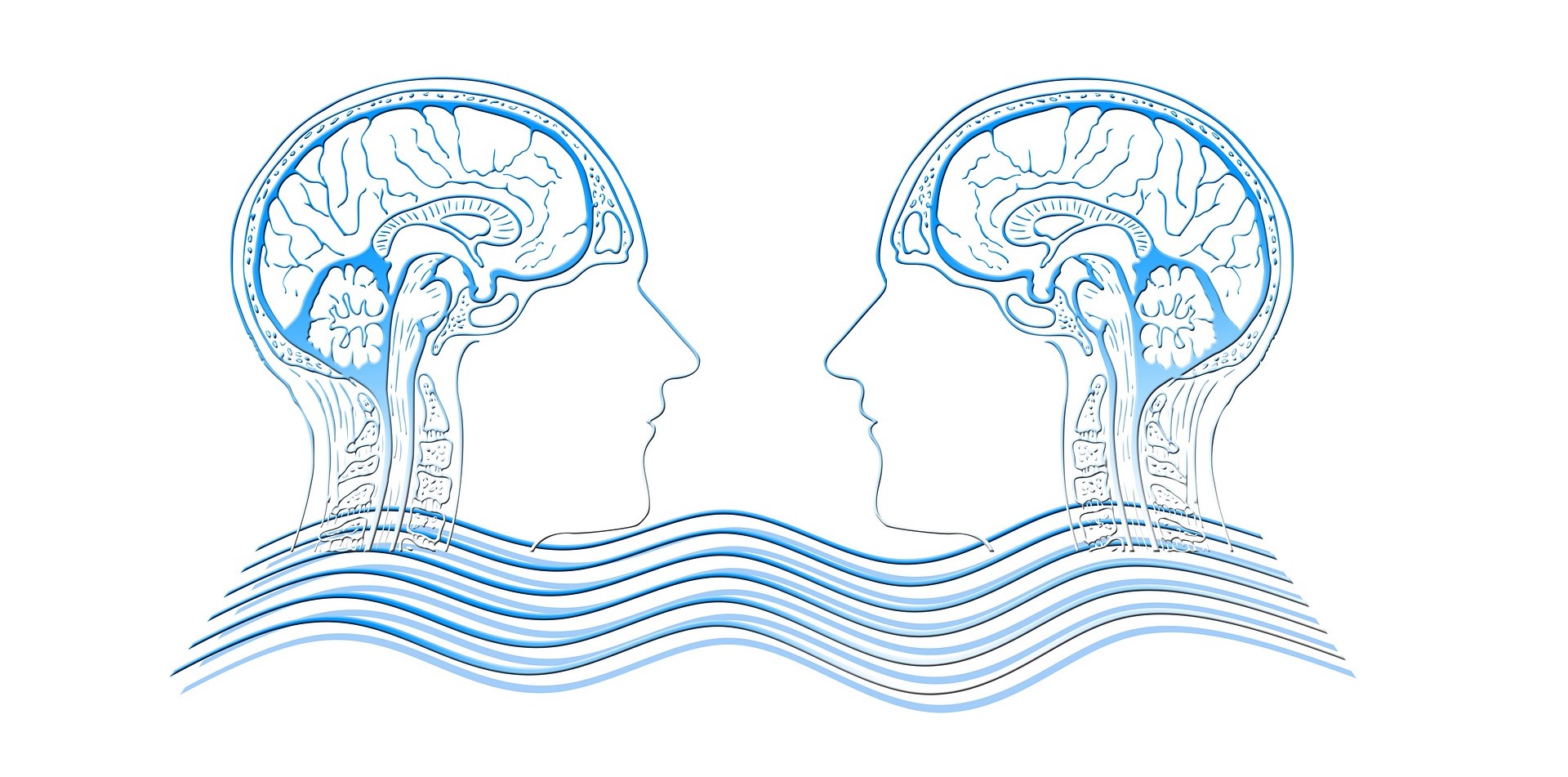Les conflits surviennent souvent lorsqu’un groupe est perçu comme ne partageant pas la même religion, la même culture, les mêmes opinions politiques ou la même origine ethnique. À la suite d’un conflit, les préjugés intergroupes sont souvent renforcés, accentuant ainsi le ressentiment à l’égard de l’autre groupe. L’étude de l’évolution des préjugés intergroupes dans les sociétés déchirées par la guerre est essentielle pour mieux comprendre la perpétuation des conflits. Une étude menée par Emilie Caspar, professeure au Centre de Recherche en Cognition et Neurosciences de l’ULB, s’est penchée sur le cas particulier du génocide au Rwanda.
Une empathie à géométrie variable
Ressentir de l’empathie pour les autres est profondément ancré dans notre biologie, car le fait de voir un autre individu en souffrance déclenche une réponse empathique dans le cerveau de l’observateur, qui nous permet de comprendre et de ressentir ce que l’autre ressent. Cependant, notre capacité à ressentir de l’empathie pour la souffrance d’autrui n’est malheureusement pas égale envers tous les êtres humains.
“Il existe de nombreux individus pour lesquels nous avons une réduction naturelle, et potentiellement inconsciente, de l’empathie. C’est notamment le cas lorsque nous sommes témoins de la douleur d’individus que nous ne reconnaissons pas comme faisant partie de notre propre groupe, et cela peut altérer notre prosocialité à leur égard”, explique-t-elle.
Le Rwanda, un cas d’école
À la suite d’un conflit, être capable de comprendre et de ressentir ce que l’autre groupe ressent est essentiel pour parvenir à la réconciliation. Or, les conflits renforcent les préjugés intergroupes, accentuant le ressentiment à l’égard de l’autre groupe.
Au Rwanda, les citoyens sont exposés à un cas unique de réconciliation intergroupe et doivent essayer de gérer leurs préjugés intergroupes causés par des décennies de conflits ethniques et le génocide contre les Tutsis.
Entre avril 1994 et juillet 1994, plus d’un million de Tutsis et quelques Hutus modérés ont été mutilés et tués dans un processus génocidaire. Cet événement dramatique de l’histoire du Rwanda semble impardonnable. Cependant, les citoyens rwandais doivent apprendre à vivre ensemble : les auteurs du génocide n’étaient pas des envahisseurs venus d’un autre pays ; ceux qui ont été tués l’ont été de la main de leurs voisins.
Les citoyens rwandais ne peuvent donc pas éviter les personnes avec lesquelles ils étaient en conflit dans le passé, et doivent être capables de gérer leurs émotions et leurs comportements envers leurs anciens agresseurs ou victimes.
« Peut-on s’attendre à ce que des individus qui ont subi des traumatismes aussi intenses, ou qui sont les descendants des victimes, soient capables d’entrer en résonance avec la souffrance des autres et de développer de l’empathie à leur égard, surtout si ces autres étaient leurs anciens agresseurs ? », demande Pre Émilie Caspar. Cela pourrait pourtant être crucial pour qu’une véritable réconciliation entre les groupes soit possible.
Une expérience sous ECG
Pre Caspar et ses collègues ont parcouru le Rwanda pour recruter d’anciens génocidaires, des survivants et leurs enfants grâce à l’aide d’associations locales. Ils ont installé leurs électroencéphalogrammes et leur matériel dans les églises ou les bars des villages ruraux, tous les endroits qui possédaient au moins quelques prises électriques.
« C’était bien sûr une aventure exceptionnelle, au-delà de l’aspect scientifique du projet. Nous touchions une population que pas un seul neuroscientifique n’avait approchée auparavant sur le terrain, et nous avons dû les convaincre d’accepter de porter un appareil bizarre sur la tête pour enregistrer leur activité cérébrale, alors que beaucoup d’entre eux n’avaient jamais vu un clavier de leur vie », ajoute Guillaume Pech, chercheur à l’ULB.
Au cours de l’expérience, les volontaires ont été invités à visualiser des images de différents individus, dont par exemple un ancien génocidaire, un survivant ou l’un de leurs descendants. Afin de déclencher une réaction d’empathie dans le cerveau de l’observateur, les images présentaient également des stimulations douloureuses ou non douloureuses sur ces individus.
« Avec une telle procédure, il est classique d’observer que le cerveau traite les stimuli comme plus douloureux lorsque l’individu présenté est considéré comme un membre du groupe interne, par rapport à un membre du groupe externe. Et c’est exactement ce que nous avons observé dans notre échantillon de volontaires, quel que soit leur groupe, et même si le génocide a eu lieu il y a 27 ans», explique Emilie Caspar.
Ce résultat suggère qu’il est difficile de se débarrasser des préjugés intergroupes au lendemain d’une telle tragédie.
Transmission transgénérationnelle
« Mais ce qui est encore plus critique, c’est que les enfants des anciens génocidaires et des survivants ont affiché les mêmes préjugés intergroupes que leurs parents, même s’ils n’ont pas vécu le conflit eux-mêmes. Ce résultat pourrait expliquer pourquoi certains conflits perdurent parfois sur plusieurs générations, car les enfants semblent avoir les mêmes préjugés que leurs parents », ajoute-t-elle.
Dans la littérature scientifique, il est reconnu qu’un traumatisme peut être transmis de génération en génération, par transmission sociale à travers des histoires par exemple, mais aussi par transmission génétique. « Il serait important de déterminer exactement comment les préjugés intergroupes sont transmis de génération en génération pour comprendre comment essayer de les réduire. »
Les chercheurs bruxellois n’ont pas la réponse à cette question, mais préparent actuellement un projet de recherche similaire au Cambodge, où un génocide mené par les Khmers rouges a tué environ 2 millions de personnes entre 1975 et 1979. Ce projet permettra de comprendre si les préjugés intergroupes sont également observables deux générations après le génocide ou s’ils commencent à s’évaporer à un moment donné.