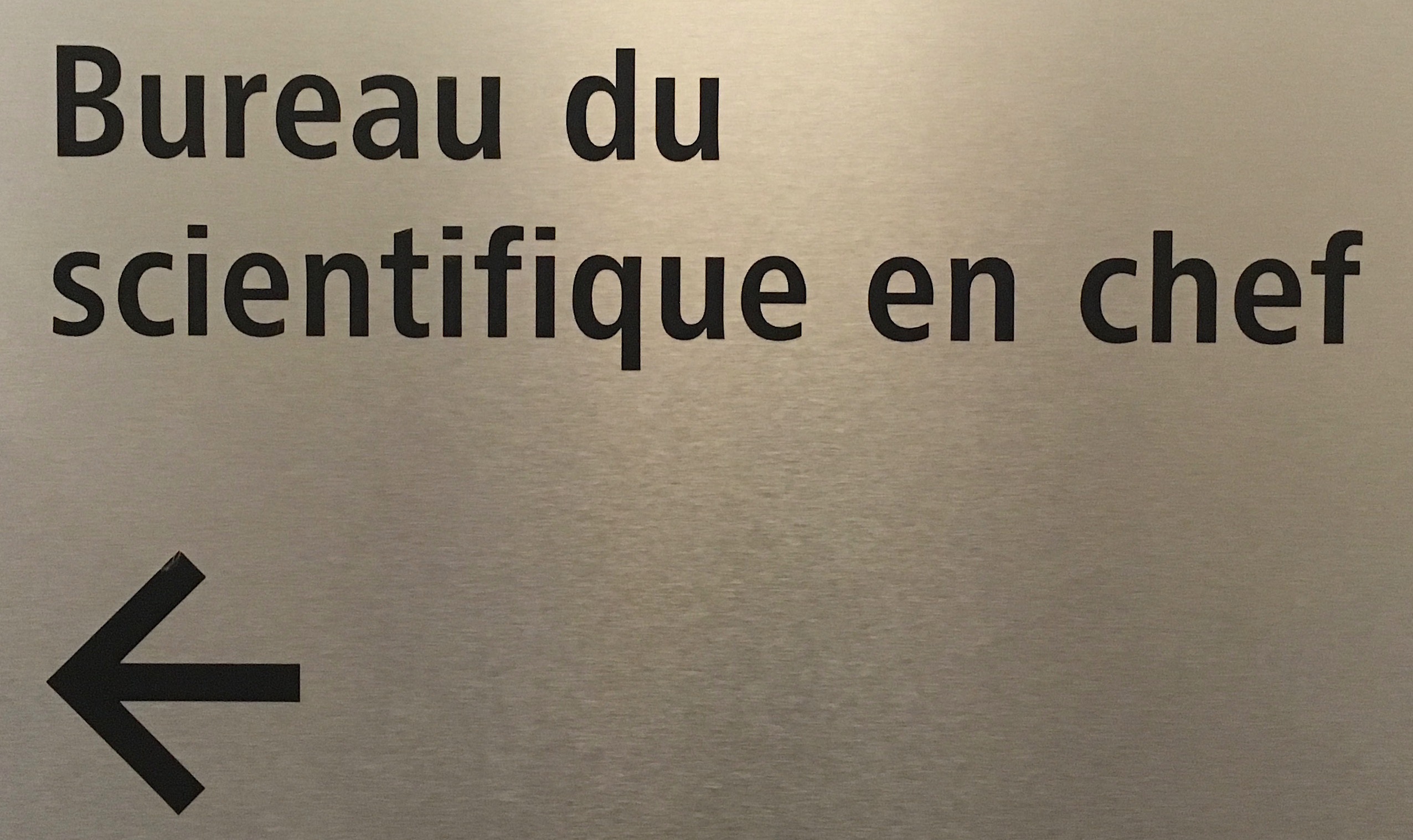SERIE (5 et fin) / Diplomatie scientifique
Le Dr Rémi Quirion est « scientifique en chef » du Québec. Une fonction qui n’existe pas en Belgique. A ce titre, il est aussi, président des trois Fonds de recherche du Québec (Nature et technologies, Santé, Société et culture).
Rencontre avec cet ancien chercheur de l’Université Mc Gill (Montréal), qui a été contraint de fermer son laboratoire de neurosciences quand il a réorienté sa carrière.
Dr Quirion, quelles sont les missions d’un « scientifique en chef »?

Cette fonction existe depuis 6 ans au Québec. Le gouvernement du Québec souhaitait à l’époque disposer d’un interlocuteur privilégié concernant les questions de recherche et d’innovation dans la province. Un interlocuteur principal capable de donner des avis, de conseiller sur différents volets liés à ces domaines. Parallèlement, j’ai également en charge les fonds de recherche. 80 % de nos programmes de recherche sont non dirigés. Les chercheurs soumettent des propositions, elles sont évaluées et certaines sont financées.
Mais j’ai aussi comme mandat la stimulation de la recherche multidisciplinaire en lien avec les grands défis auxquels devra faire face la Société comme le climat, la démographie, le vieillissement de la population. Nous avons de plus en plus besoin d’experts dans ces domaines.
Cette fonction est-elle réellement neuve?
Le concept de Scientifique en chef est très britannique. Cela n’existe pas au niveau de la francophonie mondiale. Par contre, les scientifiques en chef existent depuis 50 ans en Angleterre, en Australie, dans le Commonwealth. En Angleterre, le Scientifique en chef rend des comptes au Premier ministre tout en s’appuie sur un réseau de collègues présents dans divers ministères. Mais il ne joue pas un rôle actif dans la programmation de la recherche. Il se limite à donner des avis au gouvernement.
Au Québec, nous fonctionnons sur un modèle différent. Quand le poste de scientifique en chef a été créé, le ministre québécois de l’Économie de l’époque souhaitait s’appuyer sur le modèle britannique. Il connaissait aussi le modèle israélien, où on retrouve des scientifiques en chef dans différents ministères. Mon rôle est d’éclairer et aussi de conseiller le gouvernement sur d’éventuelles mesures à prendre, y compris à la suite de grands événements, comme les épisodes d’inondations à répétition que nous avons connus récemment. Les décideurs politiques peuvent alors prendre des décisions parfaitement informées… en ce qui concerne la science.
Informer tout un gouvernement sur les matières liées à la science et à l’innovation n’est pas un peu trop pour une seule personne?
Si je suis en effet l’interlocuteur privilégié des ministres québécois, je ne suis cependant pas seul à bord! Pour chacun des trois Fonds de recherche, je peux moi aussi prendre conseil auprès d’une quinzaine d’experts avant de répondre aux questions du gouvernement.
De quel budget disposez-vous pour mener à bien vos missions?
Pour les trois Fonds de recherche du Québec et mes diverses missions, nous bénéficiions d’un budget annuel de quelque 200 millions de dollars. En 2018, il sera augmenté de 20% . Mon budget annuel sera donc de 240 millions de dollars canadiens (soit environ 158 millions d’euros ) à partir du mois d’avril 2018.
Votre fonction vous amène-t-elle à être également une sorte de super ambassadeur de la Recherche et de l’innovation québécoises?
C’est la question de la diplomatie scientifique que vous posez là. Pour moi, cette notion porte principalement sur la manière dont la science peut aider la diplomatie.
Le Canada a été très actif dans ce domaine. Notamment en Afrique du Sud, pendant l’apartheid. Nous avions alors de programmes de recherche et de collaboration en lien avec le HIV/Sida. Nous avons pu apporter notre expertise, développer des molécules, des médicaments en Afrique. Le Canada a aussi aidé à implanter des centres de recherches en Afrique du Sud basés sur le modèle de nos propres structures.
La diplomatie peut aussi aider la science et le développement de programmes de recherche. C’est ce que nous essayons de développer avec la Palestine, lors de mission du Québec en Israël. La diplomatie peut alors ouvrir des portes au Canada pour des chercheurs palestiniens par exemple.
Quel bénéfice retire le Québec de cette diplomatie scientifique ?
Il y a une question d’image. Le Québec est fier d’être francophone dans une mer anglophone. Je pense qu’il est capable de participer à l’appui à la société francophone globale. Et l’avenir de la francophonie est en Afrique, avec son explosion démographique. Même si ce n’est pas la visée première de ce genre d’action, cela peut attirer chez nous de nouveaux étudiants, de nouveaux chercheurs, issus de ces pays francophones africains.
Cela nous permet de former les prochaines générations de chercheurs dont nous avons besoin. Ce qui se traduira aussi à terme par des retombées économiques. Le Québec disposait déjà d’un bureau à Dakar, il en ouvre un nouveau au Maghreb. C’est une de nos priorités du moment.
Quitter une brillante carrière de chercheur en neurosciences pour ce nouveau poste de scientifique en chef, cela a été un déchirement?
Parmi les conditions pour prendre ce poste, il était clair que je devais fermer mon laboratoire. Cela n’a pas été une décision simple à prendre. Une page s’est tournée, après plus de 30 ans de recherche et quelque 700 publications scientifiques. Je ne regrette pas ma décision. Ma famille scientifique, ces nombreux chercheurs, doctorants et postdoctorants avec lesquels j’ai travaillé pendant toutes ces années, est désormais disséminée à travers le monde. La recherche continue. Et en ce qui me concerne, comme scientifique en chef, j’en apprends encore tous les jours…
Ce dossier a bénéficié du soutien du Fonds pour le journalisme de la Fédération Wallonie-Bruxelles.