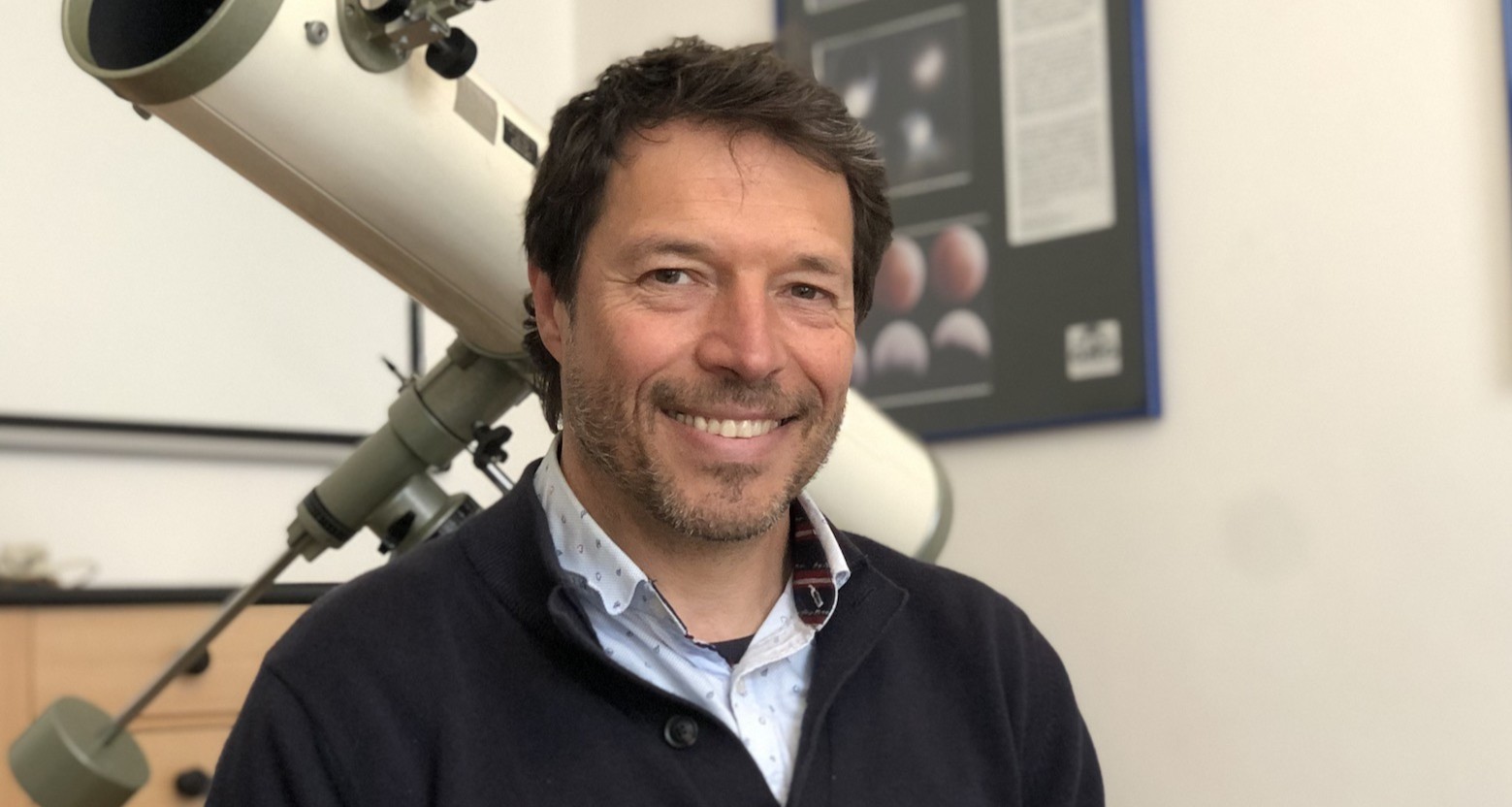La situation est alarmante. Le ciel le plus sombre et le plus pur de la planète, au cœur du désert d’Atacama au Chili, où se situe le Very large Telescope (VLT) européen et où se construit son successeur, européen également, de 39 mètres de diamètre, l’Extremely Large Telescope (ELT), est menacé par un méga projet industriel américain nommé INNA (Proyecto Integrado de Infraestructura Energética para la Generación de Hidrógeno y Amoníaco Verde).
Ce projet de grande envergure, qui s’étendrait sur plus de 3.000 hectares comprend la construction d’un port, d’usines de production d’hydrogène et d’ammoniac, ainsi que de nombreuses unités de production d’électricité. Sa proximité, à seulement 11 kilomètres de Paranal, la montagne qui héberge le VLT, aurait, comme l’expliquent dans un rapport alarmant les astronomes de l’Observatoire Européen Austral (ESO), des conséquences désastreuses et irréversibles sur la qualité des observations. Ce projet entraînerait un accroissement de 35% de la pollution lumineuse – correspondant à l’augmentation de la lumière artificielle du ciel par rapport au niveau naturel. Ce qui reléguerait le site de l’observatoire de la première place à la trentième en termes de noirceur du ciel. Mais il serait aussi responsable d’une augmentation considérable de la turbulence atmosphérique, laquelle brouille les images.
Face aux enjeux scientifiques et financiers, une intense activité diplomatique est en cours entre les ministères européens et leurs homologues chiliens en vue d’empêcher l’installation de ce complexe aussi près des observatoires. Les astronomes se mobilisent pour sauver ce patrimoine scientifique !
Des conséquences irréversibles pour l’astronomie au sol
L’impact sera considérable et direct sur la qualité des observations réalisées par ces instruments de plusieurs centaines de millions d’euros à la pointe de la technologie.
Leur capacité à détecter les astres les plus lointains dans l’Univers, qui sont aussi les plus faiblement lumineux – d’où la course aux grands télescopes – sera fortement altérée. Ceci rendrait plus complexes voire condamnerait les recherches relatives à l’un des grands objectifs de l’astrophysique : la remontée aux origines de l’Univers.
Ces perturbations limiteraient aussi la découverte d’exoplanètes à proximité de leur étoile hôte, pour laquelle la « résolution », à savoir cette capacité à détecter les plus petits détails, est directement liée à la stabilité de l’atmosphère. Cette stabilité est unique dans l’Atacama et primordiale pour ce genre d’observations. La recherche d’autres mondes, d’autres planètes habitables, est pourtant au cœur d’une révolution astrophysique, celle de la recherche de vie extraterrestre qui fascine le grand public et dépasse la question scientifique.
Face à cette menace de violation d’un des derniers sanctuaires de ciel noir de la planète, véritable Eldorado climatique pour les astronomes européens qui s’y étaient installés dans les années soixante pour déjà fuir la pollution lumineuse galopante des villes et des campagnes, force est de constater que cette pollution lumineuse n’a pas de limite !
Une pollution lumineuse venue de l’espace
A tel point que l’espace est devenu lui-même une source de pollution lumineuse avec le lancement des méga-constellations de petits satellites artificiels, comme celle du réseau STARLINK. Sur les cinq dernières années, SPACEX a envoyé plus de satellites dans l’espace que l’humanité entière durant les six dernières décennies et le lancement de Spoutnik en 1957.
Il y a aujourd’hui environ 11.400 satellites en activité dans l’espace et plus de 50.000 débris spatiaux (anciens satellites, étages de fusées, etc.) de plus de 10 cm (1,2 millions de plus de 1 cm). Et ce n’est malheureusement qu’un début, STARLINK prévoyant à terme la mise en orbite de 45.000 satellites, auxquels s’ajouteront 3.500 unités supplémentaires lancées dans le cadre de la mise en œuvre des projets OneWeb et Kuiper d’Amazon. Sans parler des projets chinois et des européens – entre autres – qui souhaitent rattraper leur retard dans ce domaine.
Les données collectées par les astronomes sont de plus en plus contaminées, compliquant fortement leur analyse voir entraînant leur perte complète. La détection des astéroïdes potentiellement dangereux pour la Terre, qui se révèlent aux yeux des scientifiques par leur déplacement rapide sur les images par rapport aux étoiles fixes, en est un exemple. Les nombreux satellites sont ainsi parfois confondus avec des astéroïdes ou empêchent simplement leur détection par les softwares automatisés.
L’observation du ciel à l’œil nu est également impactée: levez les yeux cet été, et vous verrez jusqu’à dix satellites traversant la voûte céleste en même temps, ce qui dépasse le nombre d’avions de ligne. Une situation qui a totalement changé en seulement quelques années. L’aspect du ciel immuable de beauté, juste perturbé par une ou deux étoiles filantes par heure, appartient déjà au passé. Les satellites, contrairement aux avions, tournent, en effet, inlassablement autour de la Terre et sont potentiellement visibles depuis tout point de la planète.
Trop de lumière tue la lumière
L’UNESCO célèbre ce 16 mai la journée internationale de la lumière, source de vie et indéniablement de progrès et de développement technologique pour l’humanité.
La lumière est aussi la source principale d’information des astronomes, qui avec leurs télescopes toujours plus puissants collectent les rares photons de différentes énergies – les grains de lumière – émis aux confins de l’Univers par les premières étoiles des galaxies primordiales, jusqu’aux planètes les plus proches de notre Système solaire, pour déchiffrer leurs mystères… et au final découvrir l’histoire de nos origines. Comme le disait si bien Hubert Reeves, nous sommes des poussières d’étoiles, les atomes lourds composants notre corps comme le calcium, le carbone ou l’oxygène ont été synthétisés dans les creusets cosmiques que sont les cœurs en fusion des étoiles.
L’étude des exoplanètes et de notre Système solaire permet également de mieux comprendre la formation de la Terre et de préciser les conditions de l’apparition de la vie à sa surface. Pourtant, aujourd’hui, l’excès de lumière artificielle envoyée de façon incontrôlée vers le ciel, menace de manière réelle cette quête existentielle. Mais pas que.
Biodiversité et gaspillage d’énergie
L’excès de lumière artificielle a, de surcroît, un effet délétère sur les écosystèmes nocturnes, impacte notre santé et entraîne un gaspillage énergétique considérable. Des centrales électriques sont nécessaires pour produire cette lumière qui est perdue vers le ciel et que nous payons au prix fort. Depuis les années 80, le nombre de points lumineux dans l’espace public a connu une croissance très importante.
On estime que chaque année, la pollution lumineuse augmente de 3% en Europe. En Belgique, au grand dam des astronomes amateurs, il n’existe plus aucun site où le ciel est parfaitement noir. Et en France métropolitaine, pays 18 fois plus grand et regorgeant de zones rurales et de montagnes, à peine 2% du territoire sont exempts de pollution lumineuse.
Tout comme la destruction des milieux naturels et l’épandage des pesticides, la pollution lumineuse a un impact très concret sur le monde du vivant. Plus de 60% des invertébrés et 30% des vertébrés sont nocturnes, exclusivement ou partiellement. Détruire leur habitat, c’est perturber le fonctionnement des écosystèmes. La pollution lumineuse modifie ainsi le cycle biologique, les interactions et le comportement des espèces (déplacement, prédation, pollinisation, recherche de nourriture) ce qui a d’énormes conséquences sur la biodiversité.
Patrimoine mondial de l’humanité
À cause de la pollution lumineuse, c’est l’Humanité toute entière qui se retrouve privée d’une partie de son patrimoine naturel et culturel : plus de 80% de la population mondiale vit sous un ciel pollué par la lumière. Un chiffre qui grimpe à près de 99% en ce qui concerne la population européenne. Un tiers de la population mondiale ne voit plus la Voie Lactée. Le ciel étoilé est progressivement un espace en voie de disparition. Le ciel nocturne est pourtant une source d’inspiration inépuisable depuis l’aube de l’humanité: ses mystères passionnent et intriguent, les manifestations célestes fascinent. L’observation du ciel a forgé nos cultures, nos imaginaires, nos mythologies collectives, notre science.
Le ciel étoilé a d’ailleurs été reconnu en 1992 comme patrimoine mondial à préserver par l’UNESCO.
Sensibilisations et actions
Face à la disparition des étoiles, aux impacts écologiques et énergétiques, les astronomes professionnels, amateurs et les défenseurs de l’environnement se mobilisent pour sensibiliser la population et les décideurs politiques à cette pollution encore trop méconnue. Chez les astronomes professionnels, l’International Dark Sky Association (IDA), riche de plus de 170.000 membres, a pour mission d’identifier les réserves de ciel étoilé, c’est-à-dire les zones encore préservées de la pollution lumineuse. Elle tente de les protéger avec les acteurs locaux.
Au niveau des Nations Unies, la commission UNCOPUOS “Dark and Quiet Skies” est, entre autres, chargée de compiler des recommandations d’experts pour la mise en œuvre de mesures d’atténuation des interférences des satellites et des grandes constellations de satellites sur l’astronomie.
Lors du “Earth Hour” créé par le WWF, chaque année, des millions de personnes et des villes du monde entier éteignent les lumières pour montrer leur soutien symbolique à la planète et sensibiliser aux problèmes environnementaux qui l’affectent.
En Belgique, depuis 1995, l’Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement Nocturne (ASCEN) organise chaque année la Nuit de l’Obscurité. Avec son homologue flamand, elle propose un ensemble d’animations autour du thème de la nuit. Une quarantaine de communes wallonnes et bruxelloises y ont participé en 2024, avec la collaboration des clubs d’astronomie et des groupes de défense de la nature. En France, l’initiative « villes et villages étoilés » a beaucoup de succès. Elle donne un label de « qualité du ciel nocturne » après inspection de ces entités, pour garantir un cadre de vie de qualité et valoriser un tourisme astronomique proche de la nature et de plus en plus recherché. Depuis 2021, 722 communes de France ont été labellisées.
De nombreuses solutions simples et efficaces existent pour lutter contre la pollution lumineuse, comme la conception de lampadaires ne laissant pas s’échapper la lumière vers le ciel, l’utilisation d’un éclairage adapté en intensité et intelligent (allumer uniquement quand c’est nécessaire). La mesure la plus efficace réside toutefois dans la détermination de plages horaires pour les éclairages. Cette pollution peut, en effet, être éliminée totalement et facilement en éteignant simplement la lumière.
Durant la crise énergétique de 2023, la plupart des villes belges ont décidé, par souci d’économie, de couper l’éclairage public, permettant, comme beaucoup ont pu en faire l’expérience, de revoir la Voie Lactée de nos jardins. Malgré des gains financiers réels, la plupart des communes ont toutefois revu leur position, face parfois au sentiment d’insécurité d’une partie de la population. Cet exemple nous montre combien la lutte contre la pollution lumineuse, comme la lutte contre le réchauffement climatique, est un combat difficile, qui s’immisce dans la vie quotidienne des citoyens, et nécessite une mobilisation de toutes et tous pour sensibiliser sans relâche la population et le monde politique. Et ce, afin, notamment, d’inciter ce dernier à prendre des mesures fortes et courageuses à tous les niveaux de pouvoir dans l’intérêt de l’humanité.
Note: À l’occasion de son dixième anniversaire, Daily Science donne chaque mois carte blanche à l’un(e) ou l’autre spécialiste sur une problématique qui l’occupe au quotidien. Et ce, à l’occasion d’une des journées ou semaines mondiales des Nations-Unies. Aujourd’hui, la journée internationale de la lumière.