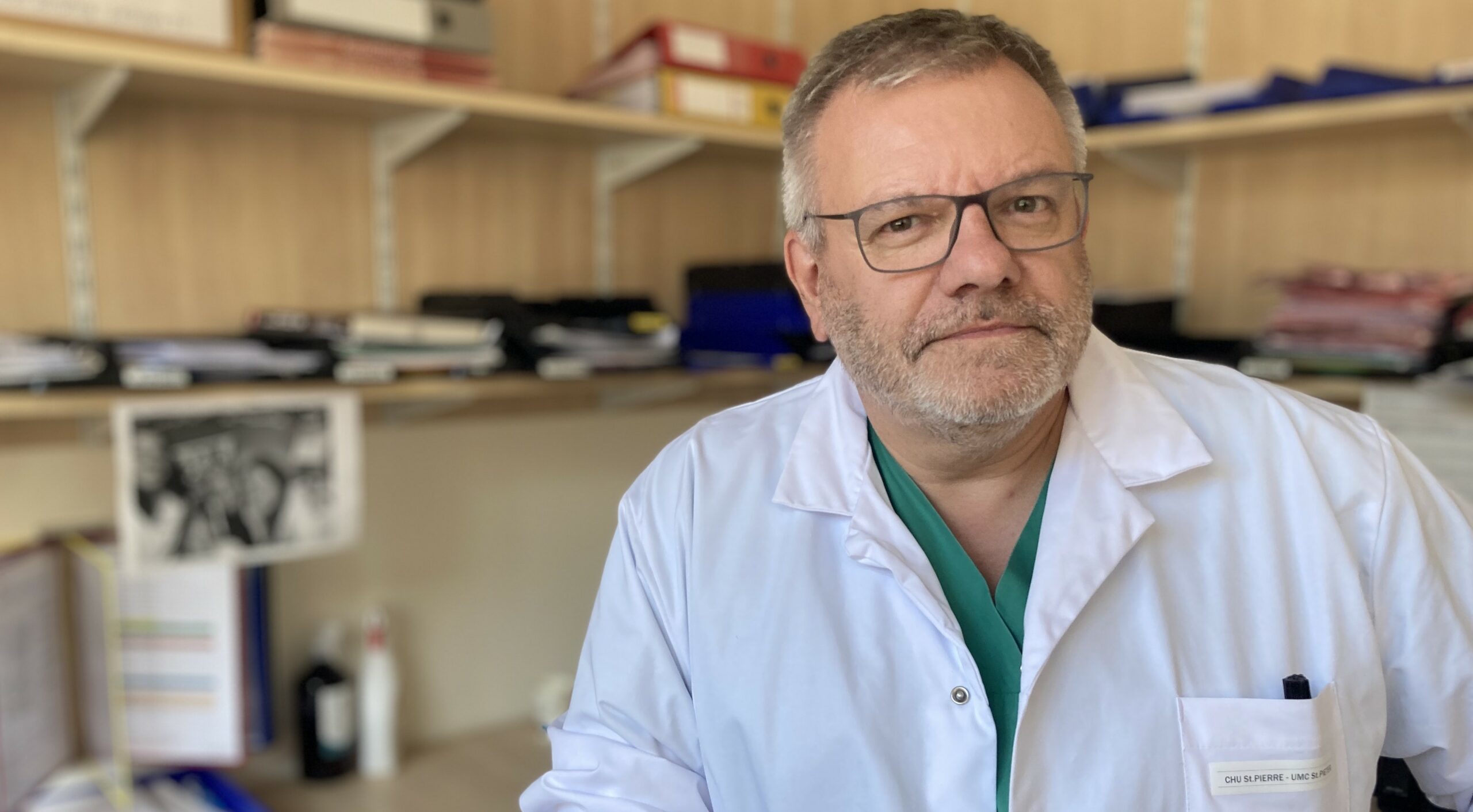Le 28 juillet, Journée mondiale contre l’hépatite, nous rappelle une réalité troublante : en Belgique, des personnes meurent encore d’une maladie qui se guérit. L’hépatite C, une infection du foie provoquée par un virus, est aujourd’hui curable dans la grande majorité des cas, grâce à des traitements simples, pris par voie orale pendant 8 à 12 semaines. Leur efficacité dépasse les 95 %. Mieux encore, ces traitements permettent d’éviter des complications graves comme la cirrhose, le cancer du foie ou la nécessité d’une transplantation hépatique.
Depuis 2016, la Belgique s’est engagée à éliminer l’hépatite virale comme menace de santé publique d’ici 2030, en accord avec les objectifs de l’OMS. Mais à cinq ans de l’échéance, nous avançons trop lentement. Ce n’est pas la médecine qui bloque : c’est l’organisation. Le virus circule principalement parmi les personnes qui échappent aux parcours de soins classiques — comme les usagers de drogues, les personnes incarcérées ou en situation de migration. Dans ces groupes, dépistage et traitement sont souvent freinés par la stigmatisation, la précarité ou une offre de soins peu adaptée.
Chez les usagers de drogues, ce sont eux qui alimentent aujourd’hui la majorité des nouvelles transmissions. La bonne nouvelle, c’est que le test rapide est désormais démédicalisé : il peut être réalisé par des intervenants de terrain, hors des structures hospitalières, ce qui facilite grandement le dépistage. Il est simple à utiliser, fiable, et de plus en plus accepté. Mais le vrai défi commence après le diagnostic. Aujourd’hui, le traitement — bien que très efficace — reste cher, n’est disponible que dans les hôpitaux, et est conditionné à l’affiliation à une mutuelle. Pour beaucoup, cela constitue un triple obstacle : administratif, financier et logistique.
Le modèle « test and treat » ne doit pas rester une ambition théorique
C’est pourquoi la prochaine étape incontournable est la mise en place d’un modèle « test and treat » réellement accessible. Cela signifie : dépister, confirmer et initier le traitement immédiatement ou dans un délai très court, idéalement là où la personne se trouve. Pour que cela fonctionne, le traitement doit pouvoir être prescrit en dehors des hôpitaux et délivré en pharmacie, avec un coût pris en charge indépendamment du statut administratif. Ce n’est qu’à ce prix qu’un véritable accès universel deviendra réalité.
Cela exige aussi une présence sur le terrain : des maraudes, des équipes mobiles, des pairs formés, une coopération entre soins, réduction des risques et services sociaux. Chaque jour perdu entre le test et la première prise est une opportunité manquée de casser une chaîne de transmission. Ce modèle « test and treat » ne doit pas rester une ambition théorique : il doit devenir la norme si nous voulons réellement infléchir l’épidémie.
Réformer la gouvernance des soins en prison
En prison, la situation est plus contrastée. L’incarcération pourrait devenir un moment opportun pour dépister et traiter, mais cela reste trop dépendant des moyens de chaque établissement, de la durée de détention, et de la collaboration — souvent imparfaite — entre la justice et les services de santé. Dans un système où la logique sécuritaire l’emporte encore trop souvent sur la logique du soin, les soignants décrivent un ensemble de dysfonctionnements structurels : manque de moyens pluridisciplinaires, lourdeurs administratives, absence de continuité à la sortie. Ces conditions entravent l’exercice clinique et compromettent l’accès équitable aux traitements.
Il est donc urgent d’uniformiser le parcours carcéral : dépistage dès l’entrée, traitement rapide, relais post-libération. Et surtout, il faut réformer la gouvernance des soins en prison : garantir une autonomie médicale, des moyens suffisants, une coordination efficace entre acteurs de la santé et de la justice. La santé en prison ne peut pas être une santé au rabais — elle est aussi un test de la crédibilité de notre éthique de soin.
Chez les migrants, une avancée majeure a été réalisée : dans les centres d’accueil, tous les stades de fibrose sont désormais éligibles au traitement, ce qui garantit une prise en charge plus équitable. Mais cette avancée reste fragile. Si la personne quitte le centre ou change de statut administratif, tout peut s’interrompre brutalement. La continuité du soin dépend alors d’un accompagnement concret, d’une information claire sur les droits et d’une orientation vers les structures de santé qui ne doit pas arriver trop tard. Sans cela, le risque de rupture est grand — et avec lui, celui de retomber dans l’errance sanitaire.
Victime de la complexité institutionnelle belge
Le fil rouge de ces enjeux ? La coordination — ou plutôt, son absence. En Belgique, les compétences en matière de santé sont éclatées entre le niveau fédéral, les régions et les communautés. Cette complexité institutionnelle génère une dispersion des responsabilités, des logiques administratives parallèles et, trop souvent, une paralysie dans l’action. Les décisions se perdent entre les niveaux de pouvoir, et l’absence de budget dédié reflète une absence de priorité politique claire.
Dans un tel contexte, la régionalisation devient un obstacle pratique à l’échelle et à la cohérence de la réponse. La fragmentation n’est pas en soi un scandale — elle est une réalité institutionnelle belge. Le scandale serait de ne pas y répondre. Une feuille de route commune, des objectifs chiffrés publics, un tableau de bord transparent et quelques indicateurs-clés suffiraient à coordonner l’action au-delà des cloisonnements. Sans volonté politique pour organiser cette cohérence, chaque avancée locale reste fragile, isolée — et inévitablement insuffisante.
Que faire maintenant ?
1. Déployer les tests rapides dans tous les lieux de vie.
2. Mettre en place un véritable modèle « test and treat » pour les usagers de drogues, avec traitement disponible en pharmacie et sans conditions d’accès.
3. Standardiser les soins en prison du dépistage à la sortie.
4. Assurer la continuité des soins pour les migrants même après leur départ des centres.
5. Réformer l’organisation des soins en prison pour garantir l’indépendance et la qualité des soins.
6. Mesurer peu, mais bien, pour pouvoir ajuster rapidement.
L’hépatite C n’est plus un défi médical : c’est un test de volonté, d’organisation et de justice. Tenir la promesse de 2030, c’est possible. Mais cela suppose de choisir d’agir maintenant.
Note 1: À l’occasion de son dixième anniversaire, Daily Science donne chaque mois carte blanche à l’un(e) ou l’autre spécialiste sur une problématique qui l’occupe au quotidien. Et ce, à l’occasion d’une des journées ou semaines mondiales des Nations-Unies. Aujourd’hui, la Journée mondiale contre l’hépatite.
Note 2 : Les intertitres sont de la rédaction de Daily Science.