Enquête : L’esprit d’aventure en sciences (1/6)
Pour engranger des connaissances au potentiel révolutionnaire, mais aussi espérer trouver des solutions aux problèmes complexes qui nous assaillent, il est crucial que les chercheurs usent de l’esprit d’aventure. Pour l’écrivain et philosophe Patrice Franceschi, quatre vertus le définissent : l’anticonformisme, le besoin de liberté, la prise de risque et le désir de connaissance.
Depuis des siècles, ces traits de caractère ont permis de faire émerger des savoirs qui ont, bien malgré eux, bouleversé les sociétés humaines. Citons le physicien allemand Wilhelm Röntgen, découvreur involontaire des rayons X alors qu’il étudiait les rayons cathodiques. En 1895, il réalisa la toute première radiographie X en éclairant la main de son épouse, révélant ses os et son alliance. Il obtint le premier prix Nobel de Physique, en 1901. Citons aussi Henri Becquerel, spécialiste de la phosphorescence qui, travaillant avec des sels d’uranium, découvre par hasard, en 1896, des radiations pénétrantes d’une nature inconnue. Deux ans plus tard, suite à la découverte du radium (plus actif encore que l’uranium) par Marie Curie, ce rayonnement prendra le nom de radioactivité.
Il n’y pas qu’en physique que la sérendipité a fait faire des bonds de géants à l’humanité, c’est aussi le cas en médecine, avec la découverte de l’anaphylaxie par Charles Richet au début du XXe siècle. En chimie, avec la découverte accidentelle du Kevlar en 1965 par Stéphanie Kwolek, scientifique de la société Du Pont de Nemours qui cherchait à améliorer les pneus des automobiles. Mais aussi en astronomie avec la découverte des pulsars, en géographie, en archéologie, etc. Les exemples sont légion.
Les chemins de traverse, bridés par la bibliométrie
Même s’il y a bien quelques scientifiques qui sortent des sentiers battus, ces dernières années, le vent soufflant dans les laboratoires est plutôt celui de se conformer à des voies de pensée dominantes, souvent allant dans le sens d’intérêts politico-économiques. Quels sont les problèmes sous-jacents et quels changements apporter pour que les chercheurs puissent envisager des idées réellement nouvelles, pour leur permettre d’explorer les chemins de traverse ? Faire émerger des éléments de réponses, c’est l’objet de cette enquête sur l’esprit d’aventure en sciences.
Notre premier point d’arrêt se cristallise sur l’importance désormais capitale, et critiquable, de la bibliométrie avec comme outil, son indice phare, le facteur d’impact. En effet, la qualité d’une recherche est aujourd’hui mesurée par le nombre de publications scientifiques.

Evolution des critères d’évaluation
« Publier est devenu le premier but de la recherche », déplore le Pr Jacques Balthazart, chercheur émérite au sein du groupe de Recherches en Neuroendocrinologie du Comportement à l’ULiège. Il a commencé à travailler dans cette université en 1971 et y a réalisé toute sa carrière. « A mes débuts, l’université disposait de budgets importants provenant du gouvernement. Elle redistribuait ces fonds à ses différents laboratoires. De quoi leur permettre de mener facilement leurs activités de recherche. »
« Ensuite, au cours des années 1970, des lois ont eu comme effet de diminuer drastiquement le financement des universités belges. Des évolutions similaires ont eu lieu dans les autres pays occidentaux. Cela a progressivement initié une course aux autres subventions et, en parallèle, une course aux publications. C’est ainsi que ces dernières sont devenues le seul critère de qualité d’une recherche. »
L’essor du régime « top-down »
« Durant cette même période, est apparue une tendance croissante à remplacer la science fondamentale basée uniquement sur la curiosité – c’est-à-dire savoir pour savoir – par une recherche motivée par les applications potentielles à plus ou moins long terme – c’est-à-dire savoir pour utiliser -. »
« Cette dernière se caractérise par des financements dits « top-down », où les sujets de recherche sont décidés par les organismes de financement. Elle se place en opposition à la démarche « bottom-up » qui subsidie des chercheurs pour faire des expériences dont ils ont eux-mêmes décidé de la finalité », poursuit le Pr Balthazart.

Détournement du facteur d’impact
Au départ, en 1975, le facteur d’impact, qui s’appelait alors Journal Impact Factor, n’était qu’une méthode quantitative d’évaluation de la qualité des journaux scientifiques. Ainsi, un journal ayant un facteur d’impact de 5 publie des articles qui sont en moyenne cités 5 fois au cours de l’année de leur publication et de l’année suivante.
« Suite à la digitalisation progressive des publications scientifiques menant à leur accessibilité informatique instantanée, le facteur d’impact a été assez rapidement, et de façon plus ou moins inconsciente, transformé en une mesure de la qualité des articles eux-mêmes. Et donc du travail des chercheurs. Conséquences ? Il en a résulté une course à la publication dans les journaux à haut facteur d’impact. Cela a été, à mon sens, très dommageable pour le fonctionnement de la science et la vie des chercheurs, ainsi que pour la qualité globale de la recherche », assène le Pr Jacques Balthazart.
Il a récemment sorti, aux éditions Iste, « Cinquante ans d’évolution de la recherche en biologie ». Il y aborde les progrès et surtout les régressions de la recherche fondamentale. C’est-à-dire celle motivée essentiellement, si pas exclusivement, par la curiosité et l’envie de découvrir des lois qui régissent le fonctionnement de l’univers.
L’exploration de nouveaux domaines dévaluée
Le facteur d’impact 2022-2023 des revues scientifiques « Science » et « Nature », les deux revues généralistes les mieux cotées, est, respectivement, de 47,7 et de 50. Du côté des revues spécialisées, le « New England Journal of Medecine » atteint 91,2, et « The Lancet » plafonne à 202,7.
Mais pour la plupart des journaux scientifiques, le facteur d’impact est inférieur à 1. C’est-à-dire que leurs articles ne sont en moyenne pas cités une seule fois. Faut-il en conclure qu’il s’agit de mauvais journaux, et que les articles qui y sont publiés sont de piètre qualité ? Ce serait aller bien trop vite en besogne. Il y a surtout des sujets à la mode et d’autres qui le sont bien moins. Une recherche qui suscitait peu d’intérêt hier peut, à la faveur de brusques problèmes de société, devenir primordiale. Rappelons-nous la pandémie de Covid-19 qui a vu le nombre de consultations et de citations d’articles sur ce sujet, auparavant marginal, littéralement exploser.
« Il faut encore noter que la recherche en sciences biomédicales ou anthropologie ne s’effectue pas à la même vitesse. Si des avancées notables peuvent être acquises dans le premier domaine endéans quelques mois, il faudra souvent plusieurs années au second. Dès lors, la période de 2 ans utilisée pour le calcul du facteur d’impact semble inadaptée aux sciences humaines », poursuit le Pr Balthazart.
« Ensuite, il dépend intimement du domaine de recherches considéré, du nombre de chercheurs qui y travaillent et du nombre de publications qu’ils produisent. Une découverte vraiment novatrice mettra un temps à s’imposer et ne récoltera donc que peu de citations dans les deux années qui suivront sa publication. »
L’utilisation du facteur d’impact a donc tendance à dévaluer l’exploration d’un domaine nouveau, la recherche à rebrousse-poil investiguée par peu de chercheurs.
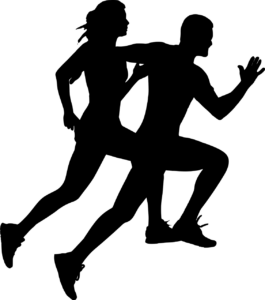
Course à la publication
Malgré ces limitations, lors d’une demande de subsides ou de promotion, il est commun de déterminer la qualité d’un chercheur à partir du nombre de ses publications et du facteur d’impact des revues où ses articles ont été publiés.
« Le mode d’évaluation basé sur les facteurs d’impact pousse les chercheurs à publier toujours plus d’articles, potentiellement plus ou moins bâclés, basés sur des observations en petit nombre peu ou mal confirmées. Et à « saucissonner» les publications importantes en une série de petits articles de manière à multiplier leur nombre. Au lieu de préparer des articles rapportant des avancées significatives, on en vient à organiser les données dans les plus petites unités publiables, les LPU pour the ‘least publishable units’ », analyse le Pr Balthazart.
Dans certains pays, les universités ouvrent leur portefeuille pour récompenser les chercheurs qui publient dans des journaux dotés d’un haut facteur d’impact. Un exemple ? L’Institut de biophysique de l’université de Beijing en Chine a accordé une prime de 275 euros par point de facteur d’impact dans un journal au facteur d’impact compris entre 3 et 7, et de 970 euros par point au-dessus de 10.
« De telles pratiques sont une incitation indirecte à la fraude incluant le plagiat et la sélection, voire la fabrication pure et simple, de données en vue de publier. La publication sélective des résultats semble être le problème le plus fréquent qui menace l’efficacité, la validité et donc la reproductibilité de la science », explique-t-il.
Changer la façon de sélectionner les chercheurs
Malgré le transfert de financements pour la recherche au niveau européen, la Belgique a toutefois conservé, et régionalisé en 1992, son propre organisme de financement de recherche fondamentale : le Fonds National de la Recherche Scientifique ou FNRS, en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le FNRS a pleinement conscience de la nécessité d’une profonde modification des méthodes d’évaluation de la recherche. Ainsi a-t-il signé, début 2022, la déclaration DORA ou San Francisco Declaration on Research assessment.
Selon cet accord, il ne faudrait plus accorder de poids dans l’évaluation des chercheurs aux noms et aux facteurs d’impact des revues dans lesquelles les travaux sont publiés. Le FNRS annonce en conséquence que l’on ne pourra plus tenir compte des facteurs d’impact des journaux où ont publié les chercheurs.
Pour faciliter l’implémentation de DORA, le FNRS demande aussi désormais aux candidates et candidats Chargés de recherche et Chercheurs qualifiés de fournir leurs 5 publications les plus représentatives de leur carrière en version complète, permettant aux évaluateurs de les apprécier qualitativement sur base de leur contenu.
Un pas en avant pour permettre aux scientifiques d’oser se lancer dans des sujets qui ne sont pas (encore) en vogue.
Cette large enquête sur l’esprit d’aventure en sciences a bénéficié du soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’esprit d’aventure en sciences (1/6) : Et si on mettait le facteur d’impact au placard?
L’esprit d’aventure en sciences (2/6) : Pour André Füzfa, « il est urgent d’abandonner la marchandisation de la science »
L’esprit d’aventure en sciences (3/6) : Quand la santé mentale défaillante des doctorants plombe leur recherche
L’esprit d’aventure en sciences (4/6) : Pour Sandrine Schlögel, « la recherche académique gagnerait à diversifier les manières de chercher»
L’esprit d’aventure en sciences (5/6) : La saga des papyrus d’Empédocle
L’esprit d’aventure en sciences (6/6) : Les végétaux bousculent notre philosophie

