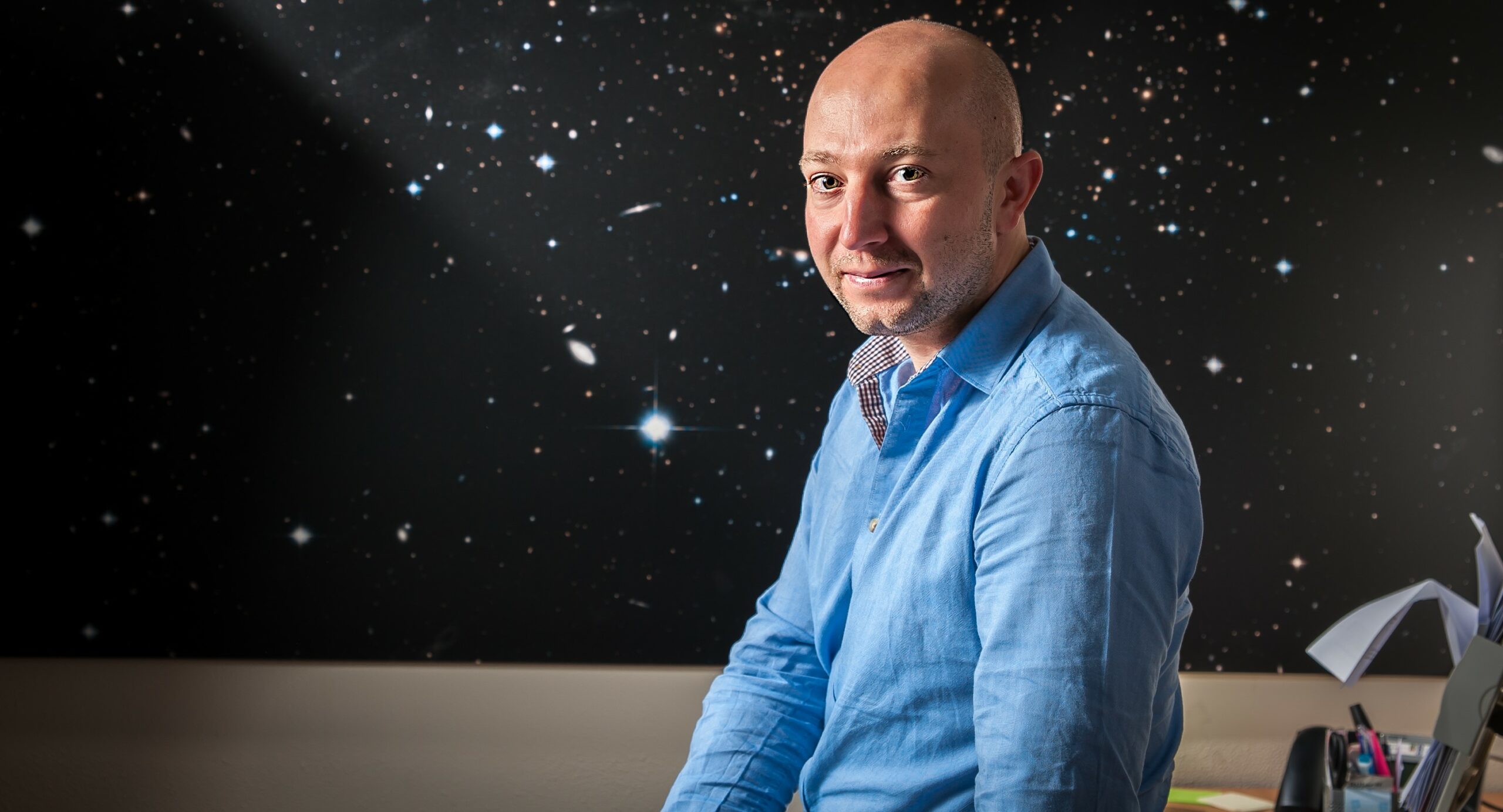Enquête : L’esprit d’aventure en sciences (2/6)
« On ne peut pas juger les gens comme on juge des entreprises. Ni en disposer, en les jetant à la poubelle quand ils ne produisent plus, pour en prendre des autres. Or, c’est trop souvent cela que l’on fait en science. » André Füzfa, professeur ordinaire au sein de l’Institut naXys à l’UNamur, expert de la théorie de la relativité d’Einstein, fustige le système impérialiste et capitaliste qui sous-tend la recherche scientifique mondiale. Et appelle à un changement profond pour réhumaniser la science et lui permettre d’être, à nouveau, désintéressée et créative. Entretien.
Daily Science (D.S.) : Que vous inspire la mise en concurrence au niveau mondial des chercheurs, poussés dans une course à la performance ?
André Füzfa (A.F.) : Je me sens profondément en porte-à-faux avec cette course à la performance, que je refuse. Elle n’est pas durable. Et ce, parce qu’elle est basée sur un modèle où les bons survivent temporairement pendant que les autres périssent et sont mis au rebut. Or, les gens ne sont pas des choses que l’on consomme et que l’on jette à la poubelle. C’est une vision du monde qui est extrêmement biaisée et malhonnête, qui broie les gens.
En termes de système humain, il n’y a aucune bonne valeur là-dedans. On ne devrait jamais parler de compétition, mais d’émulation. Et même l’émulation doit s’organiser pour éviter les travers d’une compétition sélective et castratrice, destructrice.
Cette course à la performance fabrique des égos surdimensionnés à qui on ne peut plus rien dire. C’est la dictature du vedettariat : la rock star scientifique du moment ou le prix prestigieux untel, qui se permet de donner son avis sur un sujet de société potentiellement gravissime pour lequel il n’est pas plus compétent que le citoyen lambda. Et il n’est pas rare non plus de voir d’autres abus dans le chef des vedettes : harcèlement, fraude, accaparement de résultats et autres dérapages en tous genres.
La science est un outil de l’impérialisme, dans tous les sens du terme. Et le mot est bien choisi : les puissants soutiennent la science pour qu’elle serve leur propagande tout en projetant leur influence. L’impérialisme, c’est aussi un des maux du patriarcat puisque cela sous-entend de s’imposer aux autres. Pour être publié dans des revues à haut facteur d’impact, pour se créer un CV, et finalement espérer avoir un poste, le système de la performance pousse les chercheurs à travailler avec les grosses universités. Dotées de moyens financiers conséquents, elles sont des machines à produire, à utiliser des chercheurs, à les broyer, à placer un peu partout celles et ceux qu’elle aura installées et installés comme « winners » . Ainsi se déploie l’impérialisme scientifique, en apposant la marque (dans le sens du mot anglais « brand », NDLR) de son université et en implantant partout des colonies. Cela permet d’alimenter tout un système de renommée internationale, et d’attirer des ressources humaines et financières dans un puits sans fond.
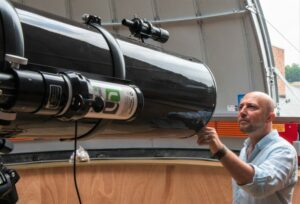
D.S. : La diversité des sujets traités par les scientifiques paraît subir l’influence néfaste de ce système. Il y a des grosses autoroutes où un maximum s’engouffre en y jouant littéralement des coudes. Emprunter les petits chemins, surtout ceux de traverse, semble risqué…
A.F. : … sauf pour les universités « d’élite » qui se ménagent ainsi le monopole de l’innovation ! S’il ou elle veut percer, un chercheur ou une chercheuse n’a d’autre choix que de s’atteler en priorité à des sujets mainstream qui sont reconnus et à la mode. Cela a comme conséquence un certain formatage : le système de la science forme davantage des techniciens et des managers que des penseuses. Il y a des effets de mode qui amènent certains sujets à être délaissés. Ils deviendront peut-être en vogue quand, simplement, ils seront défendus par un scientifique vedette ou émergeront dans une université-usine à stars.
Mais si c’est un chercheur méconnu, d’une petite université, qui réalise cette recherche de chemin de traverse, il ne sera ni écouté ni entendu, à moins peut-être qu’il s’acoquine avec une vedette. Il y a une référence à cela dans le film « Don’t Look Up », quand les présentateurs se moquent du scientifique joué par Di Caprio, professeur d’une petite université, venu alerter de l’impact prochain d’une comète sur la Terre, et qui avait pourtant raison. C’est de l’impérialisme de pensée.
Globalement, cette pression conduit clairement à une perte d’audace, de créativité, de prise de risque, puisque ces traits importants sont confisqués par les leaders. Et il existe des sujets sur lesquels il est impossible de réaliser une thèse sous peine de prendre un grand risque de griller sa réputation dans le système. Attention, par sujet risqué, je n’entends pas de la pseudoscience ou des thèses complotistes, mais bien des thèmes qui ont une base rigoureuse et sont pourtant délaissés.
Prenons l’exemple du voyage interstellaire sur lequel je bosse depuis quelques années. Ce n’est pas un sujet mainstream et il ne fait clairement pas bon y aller. Pendant toute la première partie de ma carrière, j’ai refusé de m’en occuper, car j’avais peur de me faire cramer. Et puis, un jour, j’ai compris et j’ai dit : « zut, je ne vois pas pourquoi je m’en priverais. » Et je me suis rendu compte de la présence, dans la littérature scientifique, d’articles intéressants. De douteux aussi. Il y avait des questions et des manières très pertinentes d’aborder le sujet, et qui posent des questions tant techniques que de fond. De façon même un peu anticipative, puisque le voyage interstellaire ne se fera peut-être jamais. Dans ce sujet, se cachent des questions de science, et même des questions techniques qui le rendent tout aussi noble, formateur et intéressant que d’autres sujets plus spéculatifs comme la théorie des cordes, par exemple. Et important pour l’espèce humaine.
D.S. : Autre souci : la production effrénée de connaissances sous forme de publications scientifiques…
A.F. : Les critères bibliométriques nous envoient tout droit dans le mur. Cela participe à l’impérialisme, à la commercialisation, à la marchandisation de la production de connaissances. En effet, pour réussir dans la science, il faut avoir signé un nombre indécent d’articles et surtout gonflé aux stéroïdes. Dernièrement, dans l’annonce d’un séminaire donné par un titulaire d’un prix belge prestigieux, on annonçait qu’il avait à son actif quelque 1200 articles en 45 ans de carrière ! Soit une production d’un article … environ toutes les deux semaines ! Un taux phénoménal, c’est d’abord cela qu’on nous vend. Et que l’on propose comme modèle à suivre. C’est dommage, car je suis certain que la qualité de cette personne ne se mesure pas à l’aune de ces indicateurs…
Aujourd’hui, un étudiant ou une étudiante en thèse doit produire tout de suite. Pire, obtenir certaines bourses prestigieuses est quasiment impossible sans avoir produit un article dès son … master ! Cela veut dire que ces jeunes produisent alors qu’ils n’ont pas encore fini leur apprentissage. La réalité est là. A quel moment va-t-on consacrer un an de sa carrière à maîtriser un nouveau sujet ? A développer et tester un nouvel outil ? Quand on a, enfin, obtenu un poste permanent et qu’il est alors possible de prendre certains risques. Mais il ne faut pas se leurrer, cette année de formation à un autre sujet sera reprochée par la suite lors des avancements dans sa carrière : « qu’est-ce que tu as fait pendant un an, tu n’as pas produit ? » Il faut du temps pour apprendre à appréhender le réel : le timing de la nature n’est pas celui des commissions.
L’obligation de produire, et ce, à des rythmes irréalistes, engendre, bien entendu, une perte de la créativité, et même une perte du savoir. Elle favorise l’émergence de managers parfois tyranniques et de techniciens bibliométriques, au détriment de penseuses.

D.S. : Quid du financement de la recherche ?
A.F. : J’accuse, mais je pense que c’est vrai : le système de la science est organisé pour être gravement sous-financé afin de mettre les gens dans une compétition castratrice pour accéder à des fonds rares et maigres (par rapport à d’autres secteurs comme le football…). C’est pour cela que c’est hautement compétitif, et que c’est aussi agressif. On se retrouve dès lors dans la jungle où c’est le plus méchant ou la prédatrice absolue, et pas nécessairement le ou la plus honnête, qui va tirer son épingle du jeu.
Cela explique notamment les cas de fraude, de tricherie. Plus tu reçois des sous, plus tu es soumis à la pression pour les garder et les renouveler. Ce n’est vraiment pas durable. C’est un milieu qui est organisé en système hiérarchique, pyramidal, avec le prédateur ou la prédatrice absolue tout au-dessus.
D.S. : Comment expliquer cette situation ?
A.F. : Avec le recul, je pense que c’est principalement la marchandisation du savoir qui a conduit à cette situation. A partir des années 90, on a vu l’économie du savoir (knowledge economy) prendre son plein essor avec, notamment, le développement de grands groupes éditoriaux aux intérêts commerciaux. Alors que l’un des piliers en est l’éducation, on ne peut pas dire que cela ait été conçu comme une économie durable. Au contraire, cette économie du savoir reprend les méthodes de la production compétitive, avec du capitalisme agressif. C’est tout ce modèle-là qui a été imposé à la science, qui l’a chamboulée et qui a fait émerger toutes les dérives dont on parle.
C’est la marchandisation du savoir qui a conduit à un système aveugle, bibliométrique, basé sur certaines performances. A déshumaniser la recherche.
D.S. : Mais, selon vous, ce système est en train de s’effondrer… Pourquoi ?
A.F. : Parce que les jeunes, les étudiants et étudiantes en thèse, n’en veulent plus. Nombreux refusent de faire une thèse de doctorat parce que le milieu de la science ne les attire pas en termes de valeurs et de cadre de travail. Et cela, même avant de passer par le filtre de la sélection des bourses où les taux de réjection affolants dépassent allègrement les 80%…
Les jeunes refusent ce mode de vie qui impose de s’expatrier pour réaliser 5 ou 6 séjours postdoctoraux, sans aucune garantie de contrat permanent par la suite, pour aller se faire exploiter dans des universités bien cotées dans le classement de Shanghai. Et ce alors qu’ils n’ont pas envie de déménager tous les ans et que la même recherche pourrait être faite à d’autres endroits, et dans des environnements moins toxiques. Ils refusent également de se faire broyer par des reviewers infects et partiaux, dont certains abusent manifestement de leur rôle pour défendre leur territoire. Quand leur but n’est pas simplement de tuer dans l’œuf la future concurrence.
Il n’y a plus de rêve américain. Toutes celles et tous ceux qui n’ont pas pu faire carrière, on les casse et puis ils se reconvertissent comme ils peuvent dans la société. Souvent, ça se passe mal, leur vie est brisée. C’est aussi pour ça que les jeunes ne veulent pas y aller : ils n’ont pas envie d’être celui ou celle que l’on va sacrifier. Avant de passer au suivant…
C’est grave. Car ce que nous proposons, c’est de s’intéresser à des problèmes de science fondamentale, des problèmes sur les lois du monde, l’origine de la vie, la nature profonde du réel, etc.. Ce sont des problèmes émancipatoires et formateurs dont la poursuite nous enrichit de compétences et d’humilité. On peut faire de la science de manière désintéressée dans un chouette cadre de travail. Et ce n’est jamais inutile d’être curieuse ou perspicace. Mais beaucoup de jeunes n’en veulent plus à cause de la déplorable organisation humaine de la science. Et de la perte de sens du métier. Dans la balance du choix de vie, la quête de la vérité ne pèse plus suffisamment pour contrebalancer les effets pervers et négatifs de la science telle qu’elle est organisée aujourd’hui.
D.S. : Voyez-vous une solution ?
A.F. : Il existe un courant de slow science. Bien sûr, certains collègues ricaneront sans doute, car ils considèrent que la slow science, c’est « pour les nuls qui n’ont pas réussi à s’imposer autrement, à rivaliser avec les autres ». Je les plains : comparer les gens, les dresser les uns contre les autres, les classer en « losers » ou en « winners », c’est une vision du monde qui est un prélude à la barbarie. Un bémol toutefois concernant la slow science : il ne faut pas que cela soit du « greenwashing ».
J’ai un dégoût profond de cette science triomphante et clinquante qui n’est plus un système durable. Il est grand temps de rétropédaler. Il faut dynamiter le système de marchandisation de la science. Je ne vois plus rien de bon là-dedans. Et qu’on ne vienne pas me dire que le système actuel est bon, parce que je n’y crois plus. J’ai de plus en plus souvent l’impression désagréable qu’on n’en fera jamais assez.
Ma proposition de solution à tout ceci, la voici. Il faut remettre le véritable sens de notre métier dans les priorités : la quête inachevable, formative et collaborative de la vérité. Ramener de la confiance dans le désintéressement et une pointe d’errement. Refuser la performance et opter pour l’émulation. Forger un cadre de vie pour la science où elle peut ouvrir les esprits et assurer son renouvellement dans la durée. Quitter le modèle pyramidal pour plus de transversalité, adaptée à l’universalité du réel. Réaliser, enfin, que l’intelligence est collective et doit se cultiver comme un bien commun de l’humanité.
Cette large enquête sur l’esprit d’aventure en sciences a bénéficié du soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’esprit d’aventure en sciences (1/6) : Et si on mettait le facteur d’impact au placard?
L’esprit d’aventure en sciences (2/6) : Pour André Füzfa, « il est urgent d’abandonner la marchandisation de la science »
L’esprit d’aventure en sciences (3/6) : Quand la santé mentale défaillante des doctorants plombe leur recherche
L’esprit d’aventure en sciences (4/6) : Pour Sandrine Schlögel, « la recherche académique gagnerait à diversifier les manières de chercher»
L’esprit d’aventure en sciences (5/6) : La saga des papyrus d’Empédocle
L’esprit d’aventure en sciences (6/6) : Les végétaux bousculent notre philosophie